|
ABRAHAM DANS LES TEXTES EGYPTIENS ANCIENS
John Gee
© Ensign, juillet 1992, pp. 60-61
Depuis que Joseph Smith a rattaché les fac-similés du livre d'Abraham à
l'Abraham de la Bible, certains se sont demandé si Abraham était jamais
mentionné dans les papyrus égyptiens. L'examen récent de ce dont nous
disposons prouve que le nom d'Abraham apparaît en effet dans les textes
égyptiens tardifs.
Bien entendu, accepter le livre d'Abraham, comme accepter toute Écriture,
sera toujours une affaire de foi (voir 3 Néphi 26:6-12) et la seule preuve
véritable de l’authenticité des Écritures ne peut venir que du pouvoir du
Saint-Esprit (voir Moroni 10:3-5 ; D&A 50:17-23). Mais la connaissance
d’éléments externes peut aider à la recherche de la vérité et un certain
nombre de textes égyptiens mentionnent Abraham. Après avoir accumulé la
poussière pendant de nombreuses années dans divers musées et bibliothèques,
plusieurs d’entre eux retiennent maintenant l'attention des savants.
|
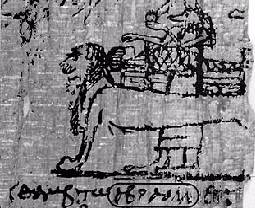
Une scène avec un lit en forme de lion
apparaît dans le papyrus de Leyde I 384 (PGM xii).
L'esquisse marque le nom d'Abraham,
écrit en grec. (Avec la permission du Rijksmuseum van Oudheden.) |
Il y a des dizaines de mentions d’Abraham dans les textes égyptiens dont
certains ont été traditionnellement qualifiés de magiques »[1] bien que
beaucoup de savants ne soient pas certains de savoir comment on fait la
distinction entre la magie antique et la religion [2]. Ces mentions sont
en cinq langues, le démotique, le vieux copte, le copte, le grec et
l'hébreu. Nous reprenons ici six des mentions d’Abraham, datant au
troisième siècle apr. J.-C., dont la plupart viennent de Thèbes, l'endroit
où les papyrus de Joseph Smith ont été trouvés ; ils ont été acquis à
l'origine par Giovanni d'Anastasi, qui les a vendus à plusieurs musées
d’Europe.
1. La première mention apparaît dans un chapitre sur la façon de faire une
chevalière. Une des étapes est de « apporter une pierre blanche » et «
écrire ce nom dessus… : Abraham, ami de l’h[omme]. »[3] (PDMxii 6-20 ;
comparer avec Apocalypse 2:17 ; D&A 130:10-11 ; Abr 3:1.)
2. Le deuxième exemple du nom d'Abraham apparaît dans une description de
la façon d’employer un anneau pour obtenir « le succès, la grâce et la
victoire ». Au cours de son invocation, le demandeur dit : « Ô dieu
puissant, toi qui surpasses tous les pouvoirs, je t’invoque, Iao, Sabaoth,
Adonai, Élohim, [six autres noms], Abraham, Isaac, Jacob, [encore 82 noms].
» Les quatre premiers noms sont hébreux et signifient « Seigneur des
armées, mon Seigneur, Dieu. »(PGMxii 270-321.)
3. La troisième mention d'Abraham vient du même papyrus que les deux
premières. Elle est accompagnée d'une image, une scène avec un lit en
forme de lion semblable à celle du fac-similé no. 1 du livre d'Abraham,
mais cette image est inversée. Une partie du texte, un charme d'amour, dit
: « Qu’Abraham qui… je t’adjure par… et incinère une telle, fille d’un
tel. Écris ces mots et dessine cette image sur un nouveau papyrus. » Plus
loin dans le texte nous lisons : « Je vous adjure, esprits des morts, [par
les pharaons] [4] et le démon Balsamos et le dieu à tête de chacal et les
dieux qui sont avec lui. » (PGMxii 474-495, PDMxii 135-164.)
Quelques explications s’imposent : « Balsamos » est probablement Baal
shammayim (seigneur des cieux), un vieux dieu phénicien et cananéen dont
on croyait qu’il avait créé la terre [5]. « Le dieu à tête de chacal » est
très vraisemblablement Anubis, qui officie habituellement dans les scènes
à lits en forme de lion, bien qu'on ne puisse le distinguer de son prêtre,
qui porte un masque de chacal sur la tête [6]. Les « dieux qui sont avec
lui » pourraient être les fils de Horus, qui sont souvent représentés sous
la forme de jarres contenant les organes internes momifiés des défunts. (Voir
le fac-similé n° 1, notes sur les figures 5 à 8.) Sur ce papyrus, la
personne qui se trouve sur le lit en forme de lion est une femme. L'idée
d'incinérer la femme comme punition au cas où elle ne céderait pas à
l'homme qui jette le charme est une vieille formule égyptienne [7].
Bien que ce papyrus soit éloigné d’Abraham, qui a vécu quelques deux
millénaires plus tôt, certains de ses éléments rappellent les trois
vierges dont parle Abraham, qui furent « sacrifiées à cause de leur vertu;
elles n'avaient pas voulu se prosterner pour adorer des dieux de bois ou
de pierre; c'est pourquoi elles furent tuées sur cet autel, et cela se fit
à la manière des Égyptiens. » (Abr. 1:11.)
Ces trois premières mentions viennent toutes du même papyrus. La mention
de « Abraham, Isaac, Jacob » nous assure que nous avons affaire à des
allusions à l'Abraham biblique. En outre, les mentions montrent un certain
lien entre Abraham et le lit en forme de lion, bien que la nature exacte
du lien soit obscure.
4. La quatrième mention d'Abraham se trouve sur un papyrus contenant
beaucoup d’allusions à la religion judéo-chrétienne ; le même scribe qui a
copié le papyrus précédent a copié celui-ci aussi. Un long chapitre sur
l’utilisation d’une lampe pour obtenir la révélation dit à l’intéressé de
s’écrier : « Ô Khopr-Khopri-Khopr, Abraham, pupille de l’œil oudjat,
quatre fois Qmr 8, créateur de la bouche, qui as créé la création, la
grande création verdoyante. » (PDMxiv 228-229.) Le nom Khopr-Khopri-Khopr
est une invocation au créateur et a des parallèles dans des textes
égyptiens plus anciens [9] et est probablement lié au fac-similé n° 2,
figure 3. Qmr semble signifier quelque chose comme « créateur, création,
plus puissant ou quelqu’un qui a le pouvoir sur. » Ici, « il est très
remarquable que le patriarche Abraham soit appelé ‘la pupille de l’œil
oudjat’. [10] » La pupille signifie ici « l’iris et la pupille » de l'œil
[11]. L’œil oudjat était un symbole de perfection, de prospérité, de
conservation, d'intégrité, d'accomplissement, de santé et de résurrection
; à l’époque chrétienne, c'était le mot que les Coptes utilisaient pour le
salut. Il apparaît quatre fois dans le fac-similé n° 2 du livre d'Abraham
(deux fois dans la figure 3 et une fois dans les figures 5 et 7).
L’œil oudjat est souvent mentionné dans un groupe de chapitres étroitement
apparentés du Livre des Morts égyptien (pp. 162-167) [12] qui traite du
thème de la préservation des morts jusqu'au moment de la résurrection.
L’un des points traités dans cet ensemble de chapitres est l’hypocéphale,
la catégorie de documents auxquels le fac-similé n° 2 appartient. Il y a
aussi d’autres liens entre le chapitre de ce papyrus « magique »et le
fac-similé n° 2 [13].
5. La cinquième mention du nom d'Abraham se rattache à une histoire
biblique. (Voir Genèse, chapitre 19.) Le chapitre du papyrus place cette
mention dans un charme d'amour (comme le troisième exemple, ci-dessus) : «
Les cieux s’ouvrirent et les anges de Dieu descendirent et détruisirent
les cinq villes : Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm et Tsoar. Quand une
femme entendit le bruit, elle devint une statue de sel. » La personne qui
utilise ce charme invoque également « le grand Michael, Souriel, Gabriel…
Istrael [sic], [et] Abraham. » (PGMxxxvi 295-310.)
6. Dans une sixième mention d’Abraham dans les papyrus, le demandeur
s’écrie : « Je t’invoque, créateur de la terre et des os et de toute la
chair et de tous les esprits et celui qui se tient sur la mer et secoue le
ciel, qui a séparé la lumière des ténèbres [comparer avec Genèse 1:4 ;
Moïse 2:4 ; Abr. 4:4], Ô grand esprit, administrateur légitime de
l'univers [voir l'explication du fac-similé n° 2, notes sur les figures 1,
3 et 7], œil éternel, daimon des daimons [14], un dieu des dieux, seigneur
des esprits [comparer avec Abr. 3:22-23], planète fixe [15] [comparer avec
l'explication du fac-similé n° 2, notes sur la figure 5], Jéhovah
[comparer avec Abr. 1:16], entends ma voix.
« Tu ne peux pas mal comprendre ma voix en hébreu : [beaucoup de mots
étrangers] Béni est mon Seigneur, le Dieu d'Abraham. Je babille dans une
langue étrangère. » Ici le demandeur se met à parler en hébreu, bien que
le texte reste en caractères grecs.
Ce sont là quelques-unes parmi les deux douzaines de mentions d’Abraham
trouvées dans des textes d'Égypte. Tous ont été découverts après que
Joseph Smith a traduit le livre d'Abraham. Beaucoup de travail reste à
effectuer avant que ces textes et leurs implications soient entièrement
analysés et compris.
Bien qu’ils ne nous disent rien de direct sur Abraham, ces textes nous
apprennent qu'il y avait des traditions sur Abraham qui circulaient dans
l’Égypte romaine. Nous devons nous rappeler que les traditions découlent
souvent de vérités plus anciennes : « On ne peut pas considérer que les
documents plus anciens doivent être préférés aux documents plus tardifs ou
que le fait de dater un document prononce un verdict sur l'âge et la
valeur historique de son contenu. Le verdict doit résider dans chacune des
traditions étudiées pour elles-mêmes [16]. » Même si nous avions un
manuscrit en égyptien pour le livre d'Abraham, datant du temps d'Abraham,
les détracteurs n'accepteraient pas le livre d'Abraham pour autant. Ceux
qui cherchent à connaître la vérité du livre d'Abraham devront se fier au
Seigneur.
NOTES
1. Les textes pour cet article viennent des sources suivantes : Karl
Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, 2 vols, Leipzig, Teubner, 1928-1931,
ci-après dénommé PGM ; F. L. Griffith et Herbert Thompson, The Demotic
Magical Papyrus of London and Leiden, 3 vols., Londres, H. Grevel, 1905,
ci-après dénommé PDM xiv ; et Janet H. Johnson, « The Demotic Magical
Spells of Leiden I 384 », Oudheidkundige mededelingen uit het rijksmuseum
van oudheden te Leiden 56 (1975), pp. 29-64, ci-après dénommé PDMxii. On
trouvera les traductions dans Hans Dieter Betz, dir. de publ., The Greek
Magical Papyri in Translation, Chicago, University of Chicago Press, 1986.
2. David E. Aune, « Magic in Early Christianity », Aufsteig und Niedergang
der römischen Weltmagie, Berlin, Walter de Gruyter, 1980),
II.23.2:1510-1516. Certains savants pensent qu’il faut laisser tomber le
terme « magie »en faveur de « religion »; voir Reinhold Merkelbach et
Maria Totti, Abrasax: Ausgewählte Papyri religiösen und magischen Inhalts,
vol. 17, band 1 de Papyrologica Coloniensia, Opladen West-deutscher Verlag,
1990, p. 1 ; Stephen D. Ricks, « The Magician as Outsider: The Evidence
the Hebrew Bible »dans Paul V.M. Flesher, New Perspectives on Ancient
Judaism, vol. 5, Lanham, MD, University Press of America, 1990, 125-134.
3. La restauration est le mot grec philen[or].
4. Neukoi peut se rapporter aux morts en général ou spécifiquement à
certains pharaons morts. Voir Manethon, Aegyptiaca, fragments 2.2, 7a.
5. Voir Harold W. Attridge et Robert A. Oden, Jr., Philo of Byblos: The
Phoenecian History, Washington, D.C.: Catholic Biblical Association of
America, 1981, 40; 81 n. 49.
6. Christine Seeber, “Maske”, Lexikon der Ägyptologie, 7 vols., Wiesbaden,
Harrassowitz, 1977-1989), 3:1196-1199.
7. Voir J. F. Borghouts, Ancient Egyptian Magical Texts (Leiden, Brill,
1978), p. 1; Paul Smither, “A Rammesside Love Charm”, Journal of Egyptian
Archaeology 27, 1941, pp. 131-132.
8. Voir à ce sujet Robert K. Ritner, “Hermes Pentamegistos”, Göttinger
Miszellen 49, 1981 pp. 73-75.
9. Voir le Papyrus Bremner-Rhind 28.20-21, dans Raymond O. Faulkner, The
Papyrus Bremner-Rhind (British Museum n° 10188), vol. 3 de Bibliotheca
Aegyptiaca, Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1933, p.
69.
10. Theodor Hopfner, “Der Religions-geschichtliche Gehalt des grossen
demotischen Zauberpapyrus”, Archiv Orientalní 7, 1935, p. 118.
11. Hildegard von Deines et Wolfhart Westendorf, Wörterbuch der
medizinischen Texte, 2 vols., vol. VII/2 de Grundriss der Medizin der
Alten Ägypter, Berlin, Akademie, 1962, 2:1004.
12. Voir Jean Yoyotte, “Contribution à l’histoire du chapitre 162 du Livre
des morts”, Revue d’Égyptologie 29, 1977, pp. 194-202.
13. Par exemple, comparez le papyrus Leyde I 383, VI.25 avec le Livre des
Morts, p. 162 ; Leyde I 383, VI.35 avec le Livre des Morts p. 164 (le
mythe est détaillé dans le livre de la vache) ; Leyde I 383, VII.30 avec
le fac-similé No. 2, figure 6, et le Livre des Morts, p. 162 ; voir
également Marie-Louise Ryhiner, « A Propos de trigrammes panthéistes »,
Revue d'Égyptologie 29, 1977, pp. 125-137.
14. Daimon dans le sens du daïmôn de Socrate dans l’Apologie de Platon
31D. C’est la divinité personnelle qui guide l’individu ; voir également
Walter Burkert, Greek Religion, tr. John Raffan, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1985, pp. 179-181; James Riddell, The Apology of Plato,
Oxford, Clarendon, 1867, pp. 101-109.
15. Pour aïôn, “monde”, dans le sens de planète, voir Irénée, Contra
Haereses I.30; II.17.5; et A. J. Welburn, “Reconstructing the Ophite
Diagram,” Novum Testamentum 23/3, 1981, pp. 262-265; il se peut que cela
remonte à Planton, Timée 38B-E.
16. John Bright, A History of Israel, 3e éd., Philadelphia, Westminster,
1981, p. 70.
|