
CHAPITRE DEUX : Hommes
de l’Orient
On peut clairement discerner
l’empreinte de l’Égypte sur le peuple de Léhi dans les noms de ces
gens et de leurs descendants. Ensemble, les noms hébreux et égyptiens
constituent l’écrasante majorité et se présentent avec une fréquence
à peu près égale, ce qui est exactement ce à quoi on s’attendrait
après l’affirmation de Mormon que les deux langues étaient utilisées
parmi eux (et qui ne serait certainement pas le cas si l’hébreu était
la seule langue parlée), mais les éléments hittites, arabes et ioniens
ne manquent pas. Considérons tout d’abord quelques noms égyptiens, en
opposant les noms du Livre de Mormon (LM) à leurs équivalents de
l’Ancien Monde (AM)[1].
Aha, (LM) fils
du commandant en chef néphite.
Aha (AM) nom
du premier pharaon ; il signifie « guerrier » et est un mot courant.
Aminadad
(LM) missionnaire néphite de l’époque des juges.
Amanathabi (AM) chef d’une ville cananéenne sous la domination égyptienne. Le
nom est de l’égyptien «réformé».
Ammon (LM) nom le plus courant du Livre de Mormon.
Ammon (Amon, Amun) (AM) le nom le plus courant de l’empire
égyptien : le grand Dieu universel de l’empire.
Ammoni-hah (LM) nom d’un pays et d’une ville.
Ammuni-ra
(AM) prince de Beyrouth sous le gouvernement égyptien. Le nom ci-dessus
peut avoir le même rapport avec celui-ci que Cameni-hah
(LM) général néphite, avec Khamuni-ra (AM) nom de
personne d’Amarna, peut-être l’équivalent de Ammuni-ra[2].
Cezoram (LM) grand juge néphite.
Chiziri (AM) gouverneur égyptien d’une ville syrienne.
Giddonah (LM) a) grand prêtre qui jugea Korihor b) père
d’Amulek
Dji-dw-na (AM) nom égyptien de Sidon.
Gidgiddoni et Gidgiddonah
(LM) généraux néphites.
Djed-djhwt-iw-f et Djed-djhwti-iw-s plus ankh (AM) noms propres égyptiens
signifiant respectivement « Thoth a dit : il vivra » et « Thoth a dit :
Elle vivra »[3]. Suivant ce modèle, les deux noms néphites signifient
respectivement « Thoth a dit
: Je vivrai » et « Thoth a dit : Nous vivrons. »
Giddianhi
(LM) chef et général pillard.
Djhwti-anki
(AM) « Thoth est ma vie » ; voir ci-dessus.
Gimgim-no
(LM)
ville de Gimgim, comparez le biblique No Amon, « Ville d’Amon ».
Kenkeme (AM) ville égyptienne, cf.
Kipkip siège de la dynastie égyptienne de Nubie.
Hem (LM) frère du premier Amon.
Hem (AM) signifie « serviteur
» – particulièrement d’Amon, comme dans le titre « Hem tp
n’Imn » ; « serviteur principal d’Amon » que détenait le grand prêtre
de Thèbes.
Hélaman (LM) grand prophète néphite.
Her-amon
(AM), « dans la présence d’Amon », comme dans le nom propre égyptien
Heri-i-her-imn[4]. Le sémitique « l » est toujours écrit « r » en égyptien,
qui n’a pas de « l ». Inversement l’égyptien « r »
est souvent écrit « l » dans les langues sémitiques.
Himni (LM) fils du roi Mosiah.
Hmn (AM) nom du dieu-faucon égyptien, symbole de
l’empereur.
Korihor (LM) agitateur politique dont
s’empara le peuple d’Amon.
Khérihor (également
écrit Khurhor, etc.) (AM) premier grand prêtre d’Ammon qui s’empara
du trône d’Égypte à Thèbes vers 1085 av. J.-C.
Manti (LM) nom d’un soldat néphite, d’un pays, d’une
ville, d’une colline.
Manti (AM) forme sémitique d’un nom propre égyptien par
exemple Manti-mankhi, prince de Haute-Égypte vers 650 av. J.-C. C’est une forme tardive de
Month, dieu de Hermonthis.
Mathoni (LM), un disciple néphite.
Maitena, Mattenos, etc. (AM), deux juges de Tyr, qui, à des moments différents,
se firent rois, peut-être sous les auspices des Égyptiens.
Morianton (LM) nom d’une ville néphite et de son fondateur ;
cf. la province néphite de Moriantum.
Meriaton et Meriamon (AM) noms de princes égyptiens
respectivement « bien-aimé d’Aton » et « bien-aimé d’Amon
».
Néphi (LM) fondateur de la nation néphite.
Néhi, Néhri (AM) nobles égyptiens célèbres. Nfy
était le même nom que celui d’un capitaine égyptien. Puisque
le LM insiste sur « ph », Néphi est plus proche de Nihpi
nom original du dieu Pa-nepi, qui a peut-être même pu être Néphi[5].
Paanchi (LM) fils du Pahoran, père, prétendant au siège du
grand juge.
Paanchi (AM) fils de Kherihor, a) premier grand prêtre
d’Amon, b) gouverneur du sud qui conquit toute l’Égypte et fut grand
prêtre d’Amon à Thèbes.
Pahoran (LM) a) grand juge suprême, b) fils du personnage du
même nom.
Pa-her-an (AM) ambassadeur d’Égypte en
Palestine où son nom a l’orthographe « réformée » Pahura ; en égyptien,
sous sa forme Pa-her-y, il signifie « le Syrien » ou l’Asiatique.
Pacumeni
(LM) fils de Pahoran.
Pakamen
(AM) nom propre égyptien signifiant « aveugle » ; également Pamenches
(grec Pachomios), commandant du sud et grand prêtre d’Horus.
Pachus
(LM) chef révolutionnaire usurpateur du trône.
Pa-ks et Pach-qs (AM) nom propre égyptien. Comparez Pa-ches-i,
« il est loué ».
Sam (LM), frère de Néphi.
Sam Tawi (AM) égyptien « unificateur des pays », titre pris
par le frère de Nehri en montant sur le trône.
Seezor-am et Zeezr-om (LM) respectivement juge dépravé
et homme de loi, le dernier nom étant également le nom d’une ville.
Zoser, Zeser etc., (AM) gouverneur de la troisième dynastie, un
des plus grands pharaons.
Zemna-ri-hah
(LM), chef de brigands.
Zmn-ha-re (AM), nom propre égyptien ;
les mêmes éléments que ci-dessus dans un ordre différent : une
pratique égyptienne courante.
Zénif (LM) chef d’une colonie néphite.
Znb, Snb (AM) éléments très courants dans les
noms propres égyptiens, cf. Senep-ta.
Zenoch
(LM) selon divers auteurs néphites, un ancien prophète hébreu.
Zenekh
(AM) nom propre égyptien, autrefois un dieu serpent.
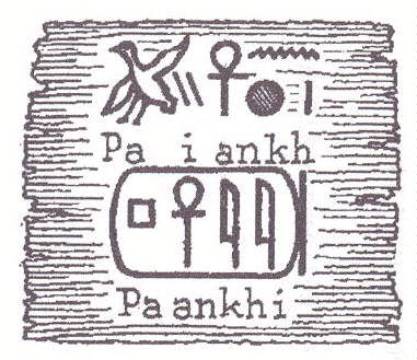
Paiankh, fils de Kherihor et premier grand prêtre d’Ammon. Le nom, sous la forme Paankhi, est porté par deux souverains du Sud, dans les premier et quatrième rois de la XXVe Dynastie. Il est absolument identique au Paanchi d’Hélaman 1:3.
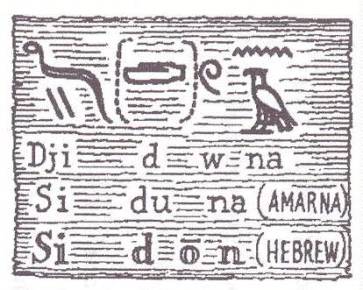
La forme égyptienne du nom
Sidon se dit à peu près Djidonah (le « d » très fort), suggérant le
nom propre Giddonah dans le Livre de Mormon. La forme hébraïque est très
courante dans le Livre de Mormon. (Tiré de Max Burchardt, « Altkanaanaischen Fremdworte », d’après W.
F. Albright, « Vocalization of the Egyptian Syllabic Orthography », p.
67.)
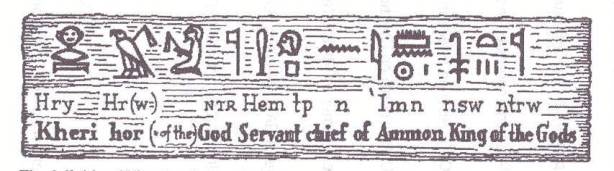
Kher hor servant (officiant) en Chef d’Ammon Roi
des Dieu
Le titre complet de Khérihor avant qu’il ne devienne roi de Thèbes.
Dans le Livre de Mormon (Alma 30), Korihor est envoyé par Ammon, dont la
fonction de grand prêtre du peuple d’Ammon comporte des fonctions
judiciaires et politiques importantes, pour être jugé devant « le grand
prêtre et le grand juge du pays ». C’est justement une autorité
combinée et générale de ce genre que détenait Khérihor en Égypte, en
tant que premier serviteur (Hem) d’Amon. L’Ammon du Livre de Mormon a
un frère du nom de Hem.
On remarquera que les noms comparés sont rarement exactement
les mêmes, sauf dans le cas des monosyllabes Sam et Hem. Aussi étrange que cela
paraisse, c’est là une confirmation puissante de leur origine commune,
puisque les noms subissent fatalement des changements avec le temps et la
distance, alors que si la ressemblance était parfaite, nous serions forcés
de l’attribuer, aussi fantastique que cela puisse paraître, à une
simple coïncidence. Il doit y avoir des différences
; et ce n’est pas tout : ces différences ne doivent pas être au
petit bonheur, mais montrer des tendances précises. Cela nous amène à
un aspect extrêmement impressionnant des noms du Livre de Mormon.
Prenons par exemple le cas
d’Ammon. Comme c’est un nom si courant, on
s’attend à le retrouver dans des composés aussi bien que seul, et
c’est effectivement l’élément le plus courant des noms composés, en
Amérique comme en Égypte. Mais dans les noms composés, Amon ou Amun
change de forme en suivant une règle générale. Gardiner dit dans sa grammaire
égyptienne :
Une catégorie très
importante de noms de personnes est celle qui contient des noms dits théophores,
c’est-à-dire des noms composés dont un élément est le nom d’une
divinité. Or dans les transcriptions gréco-romaines, il est de règle
que lorsqu’un nom divin de ce genre se trouve au commencement
d’un composé (les italiques sont de Gardiner), ce nom est moins
fortement vocalisé que lorsqu’il est indépendant ou à la fin d’un
composé[6].
L’auteur poursuit alors en montrant que dans de tels
cas, Amon ou Amun devient régulièrement Amen, tandis que dans certains
cas, la voyelle peut entièrement disparaître. Il suffit de considérer Aminidab, Aminadi, Amminihu, Amnor etc., dans le
Livre de Mormon pour voir à quel point la règle s’applique bien sur le
continent américain. D’autre part, dans le nom Hélaman, la
vocalisation forte reste, puisque le « nom divin » n’est pas « énoncé
au commencement » du composé. Puisque le sémitique « l » doit
toujours être rendu « r » en égyptien (qui n’a pas de « I ») Hélaman
apparaîtrait nécessairement en égyptien « non réformé » sous la
forme typiquement égyptienne de Heramon.
La grande fréquence de l’élément
Mor- dans les noms propres du Livre de Mormon s’accorde d’une manière
frappante avec le fait que, dans les listes de noms égyptiens dressées
par Lieblein et Ranke, l’élément Mr est de loin le plus courant après
seulement Nfr. Dans un article paru en avril 1948 dans « l’Improvement
Era », l’auteur attirait l’attention sur la tendance particulière
qu’avaient les noms du Livre de Mormon à se concentrer en Haute-Égypte
à Thèbes et dans le sud de Thèbes. À l’époque, il ne savait pas
comment expliquer cet étrange phénomène, mais la réponse est
maintenant claire[7]. Lorsque Jérusalem tomba, la plupart des contemporains
de Léhi qui s’échappèrent se rendirent en Égypte, où leur colonie
principale semble avoir été située à Éléphantine ou Yeb, au sud de
Thèbes. En fait, il semblerait que la colonisation principale
d’Éléphantine ait eu lieu à cette époque et en provenance de Jérusalem[8]. Quoi donc de plus naturel que les réfugiés qui se
sont enfuis en Égypte en venant de la Jérusalem de Léhi aient eu des
noms du Livre de Mormon, puisque le peuple de Léhi a puisé ses noms à
la même source ?
Il y a une objection sérieuse, que l’on ne doit pas
laisser sans réponse, à l’utilisation des noms du Livre de Mormon
comme preuve philologique. En voyant devant lui ces mots étranges,
comment Joseph Smith, illettré comme il l’était, aurait-il pu savoir
comment les prononcer? Et en les entendant, comment son secrétaire à
moitié instruit aurait-il pu savoir les écrire phonétiquement? Il faut
se souvenir que ces noms ne sont pas des traductions en anglais comme le
reste du livre, mais restent des échantillons de la langue néphite
authentique. À elles deux, les supputations du prophète quant à la manière
de les prononcer et les supputations d’Olivier Cowdery quant à la
transcription devraient fatalement faire un massacre complet des titres
originels. Seulement, il n’a pas été question de deviner. Selon David
Whitmer et Emma Smith, dans des interviews qui parurent dans The Saints
Herald et sur lesquelles Preston Nibley a attiré l’attention de
l’auteur, Joseph ne prononçait jamais les noms propres qu’il
rencontrait sur les plaques au cours de la traduction, mais les épelait
toujours[9]. Il ne fait donc aucun doute que, tels qu’il sont, ils
sont censés être aussi précis et authentiques qu’il est possible de
les rendre dans notre alphabet.
Mais l’Égypte n’était pas tout. La Palestine a
toujours été un creuset et ce, plus que jamais à l’époque de Léhi,
au moment où le Proche-Orient tout entier subissait un brassage intensif
sous l’effet du commerce et de la guerre. Les listes d’ouvriers spécialisés
vivant à Babylone immédiatement après la chute de Jérusalem révèlent
un mélange presque incroyable de types[10]. Étant donné que Joseph Smith avait accès à
l’Ancien Testament, il ne sert à rien de donner la liste des noms hébreux,
mais leurs formes dans le Livre de Mormon sont significatives. La forte
tendance à terminer en - iah est très frappante, car la vaste majorité
des noms hébreux que l’on a trouvés à Lakisch se terminent de la même
manière, révélant que les noms en -iah étaient à la mode à l’époque
de Léhi[11]. Les noms hébreux découverts en d’autres endroits
sur d’anciennes poignées de cruches ont également une consonance
apparentée au Livre de Mormon : Hezron, Mamshath, Ziph (LM Zif), Jether,
Epher, Jalon, Ezer, Menahem, Lecah, Ammon (LM Amnor), Zoheth, etc.[12], ne seraient jamais suspects si on les insérait dans
une liste de noms du Livre de Mormon. Le Livre de Mormon donne le type
correct de nom hébreu.
Ce qui est surprenant, c’est
qu’un certain nombre de noms du Livre de Mormon sont probablement
hittites et que certains le sont indubitablement. C’est ainsi que si
Manti suggère l’égyptien Monti, Manti, Menedi, etc., il rappelle également
le nom égyptien d’une ville hittite, Manda, et un élément caractéristique
des noms hurriens (une grande partie du hittite est en réalité hurrien,
comme l’a montré le professeur Goetze), - anti, andi, également assez
courant dans le Livre de Mormon[13]. De même Kumani, Kumen-onhi,
Kisk-kumen (ég.- hittite Kumani, ville
importante), Séantum (égypt.-hittite Sandon, Sandas), Akish (égypt.-hittite
Achish, nom de Chypre), Gadiandi (égypt. pour désigner une ville hittite, Cadyanda)[14]. Leur
forme égyptienne implique que ces noms ont atteint le peuple de Léhi non
pas directement, mais par des itinéraires normaux, bien qu’il ait été
récemment montré que certains des contemporains importants de Léhi étaient
Hittites et que les colonies et les noms hittites survivaient encore de
son temps dans la région montagneuse de Judée[15].
La présence des noms Timothée
et Lachonéus dans le Livre de Mormon est tout à fait normale, aussi étrange
que cela puisse paraître à première vue. Depuis le quatorzième siècle
avant Jésus-Christ au plus tard, la Syrie et la Palestine étaient en
contact constant avec le monde égéen, et depuis le milieu du septième
siècle, les mercenaires et les marchands grecs, intimement liés aux intérêts
égyptiens (les meilleurs mercenaires égyptiens étaient grecs),
pullulaient dans tout le Proche-Orient[16]. Le peuple de Léhi, même en dehors de ses activités
mercantiles, n’aurait pas pu éviter de nombreux contacts avec ces gens
en Égypte et surtout à Sidon, que les poètes grecs, même à cette époque,
célébraient comme étant le grand centre mondial du commerce. Il est intéressant
de noter, en passant, que Timothée est un nom ionien, puisque les Grecs
de Palestine étaient Ioniens (de là le nom hébreu donné aux Grecs : «
fils des Javanim »), et, puisque « Lachonéus » signifie « Laconien »,
que les plus anciens commerçants grecs étaient des Laconiens, qui
avaient des colonies à Chypre (Akish dans le Livre de Mormon) et
faisaient évidemment commerce avec la Palestine[17]. L’auteur était autrefois très intrigué par
l’absence totale de noms en Baal dans le Livre de Mormon. Par quel oubli
malheureux les auteurs de ce livre avaient-ils négligé d’introduire le
moindre nom contenant l’élément Baal, qui a tant de succès dans les
noms de personnes de l’Ancien Testament ? Ayant découvert,
pensions-nous, que le livre se trompait, nous n’avions pas épargné nos
critiques à l’époque ; et de fait, si son dédain des noms en
Baal n’avait pas été justifié de manière frappante ces dernières
années, ce serait un mauvais point pour lui. Il se fait que nous avons
maintenant appris que le dédain obstiné de notre texte à l’égard des
noms en Baal est en fait la seule attitude correcte qu’il aurait pu
adopter, et cette théorie, qui va à l’encontre de tous nos calculs et
de toutes nos idées acquises, devrait, en toute honnêteté, militer au
moins autant en faveur du livre que que la soi-disant erreur militait
contre lui.
Il se fait que, pour une
raison ou pour une autre, les Juifs, au commencement du 6e s. av. J.-C.,
ne voulurent plus rien avoir de commun avec les noms en Baal. L’étude
des listes de noms d’Éléphantine révèle que « le changement des
noms en Baal, par substitution, s’accorde avec la prédiction d’Osée
que les Israélites ne s’en serviraient plus, et, par conséquent, il
est extrêmement intéressant de constater que les découvertes archéologiques
les plus récentes confirment le prophète, car sur environ quatre cents
noms de personnes dans le papyrus d’Éléphantine, il n’en est pas un
qui soit composé de Baal »[18]. Puisque Éléphantine
fut colonisée essentiellement par des Israélites qui s’étaient enfuis
de Jérusalem après sa destruction, leurs noms de personnes devraient
montrer les mêmes tendances que ceux du Livre de Mormon. Bien que le
traducteur de cet ouvrage ait pu, par l’exercice d’une ruse
surhumaine, avoir été averti par Osée 2:19 qu’il devait éviter les
noms en Baal, cependant le sens de ce passage est si loin d’être évident
qu’en 1942 encore, Albright trouve « ... très significatif que des
sceaux et des inscriptions de Juda qui ... sont très nombreux au septième
et au début du sixième [siècles], semblent ne jamais contenir de noms
en Baal »[19]. C’est en effet très significatif, mais pas plus que
le flair étrange que manifeste le Livre de Mormon dans ce domaine.
Parlant de la présence d’un petit nombre de noms
arabes dans l’Ancien Testament, Margoliouth observe : « Considérant
... que les noms écrits sont ceux d’une fraction infinitésimale de la
population, la coïncidence est extraordinaire[20] ». Cet état de choses s’applique avec une grande force
au Livre de Mormon, où les nombreux noms coïncidant avec les formes de
l’Ancien Monde ne représentent « qu’une fraction infinitésimale »
de la population néphite.
Léhi était très riche et c’était un commerçant, car sa richesse
avait la forme de « toutes sortes de choses précieuses » du genre que
l’on devait aller chercher en divers endroits. Son monde était un monde
de voyageurs et de marchands. Les princes du Delta étaient marchands[21], les
princes des villes syriennes et palestiniennes l’étaient aussi, comme
le montrent les tablettes d’Amarna; l’histoire de Wenamon nous raconte
que les princes de Phénicie et de Philistie étaient marchands; les
princes arabes du désert étaient marchands, et les marchands d’Égypte
et de Babylonie se réunissaient dans leurs tentes pour faire leurs
affaires[22] ; Solon et Thalès, les deux
hommes les plus sages d’entre les Grecs et grands contemporains de Léhi,
voyagèrent tous les deux beaucoup en Orient – pour affaires.
Une chose très significative, c’est la
remarque faite au passage que Léhi avait un jour eu une vision dans un
endroit désert « tandis qu’il voyageait » (1 Néphi 1:5). Tandis
qu’il voyageait, il pria, nous dit-on, et tandis qu’il priait, il eut
une vision. L’effet de cette vision fut de le faire revenir en hâte «
vers sa propre maison à Jérusalem », où il eut des visions encore plus
grandes montrant qu’il ne lui était pas nécessaire de « voyager »,
que ce soit pour prier ou pour avoir des visions; il ne partit pas en
voyage en s’attendant à avoir une vision – car lorsque cette vision
vint, il retourna immédiatement chez lui – mais une vision lui fut donnée
au cours d’un voyage ordinaire, tandis qu’il vaquait à ses affaires,
le forçant à changer ses plans.
Ses choses précieuses et son or, Léhi les avait obtenus en échange de
son vin, de son huile, de ses figues et de son miel (sur lesquels il
semble connaître pas mal de choses), non seulement par mer, (de là la
grande importance de Sidon), mais nécessairement et spécialement aussi
par caravane. « Israël, dit
Montgomery, était « tourné vers le désert. » Il n’y avait que là
qu’il lui était possible de trouver commercialement du profit, via les
grands itinéraires commerciaux ...vers la Syrie ...vers la Méditerranée
et l’Égypte ...vers l’Euphrate et le Golfe Persique. « À l’ouest,
il était bloqué par les Égyptiens, les Philistins, les Phéniciens et
les Syriens, meilleurs commerçants que les Hébreux. » Puisque l’Égypte
dominait ce commerce à l’ouest, il est facile de voir en quoi Léhi
pouvait trouver son avantage en tirant le meilleur parti de sa formation
et de sa culture égyptiennes. Bien que ces débouchés occidentaux
fussent ouverts du temps de Léhi, grâce à une politique de
collaboration étroite avec les puissances occidentales contre la
Babylonie, la règle était toujours que le commerce par le désert, et en
particulier le désert du sud, était la seule source de richesses digne
de confiance pour les hommes de Jérusalem[23].
Il est amplement prouvé dans le Livre de Mormon que Léhi, comme on
pourrait s’y attendre, était expert en voyages par caravane. Réfléchissez
à quelques considérations générales. En recevant un songe avertisseur,
il est apparemment prêt d’un moment à l’autre à emmener toute « sa
famille, des provisions et des tentes » dans le désert (1 Néphi 2:4).
Tout en ne prenant absolument rien d’autre que les provisions
indispensables (1 Néphi 2:4), il savait exactement ce que devaient être
ces provisions, et lorsqu’il dut renvoyer ses fils à la ville afin de
pourvoir à des besoins inattendus, ce furent des documents qu’il les
envoya chercher, pas des choses nécessaires au voyage. Ceci présuppose
un niveau élevé de préparation et de connaissance chez cet homme, tout
comme la manière magistrale avec laquelle il établit un camp de base
pour rassembler ses forces en vue du grand voyage, à la meilleure manière
des explorateurs modernes en Arabie[24].
Jusqu’au moment où Léhi quitte ce camp de base, c’est-à-dire
jusqu’au jour où il reçoit le Liahona, il semble savoir exactement où
il va et ce qu’il fait: il n’est pas question ici d’être « guidé
par l’Esprit, ne sachant pas d’avance... » comme c’est le cas de Néphi
dans les rues sombres de Jérusalem (1 Néphi 4:6).
Sa famille accuse Léhi de folie parce qu’il quitte Jérusalem et n’épargne
pas ses sentiments personnels en se moquant de ses songes et de ses
visions, et cependant elle ne met jamais en doute sa capacité de la
diriger. Elle se plaint, comme tous les Arabes, des déserts
terribles et dangereux qu’elle traverse, mais, parmi les dangers, elle
ne mentionne pas l’ignorance du désert, alors que ce serait son
objection sans réplique à ce projet insensé, si le vieil homme n’était
qu’un Juif de la ville ignorant le monde sauvage et dangereux du désert.
Léhi lui-même ne compte jamais le manque d’expérience parmi ses
handicaps. Les membres de sa famille ricanent avec mépris lorsque Néphi
propose de construire un bateau (1 Néphi 17:17-20) et auraient aussi bien
pu citer l’antique proverbe: « Ne montre pas à un Arabe la mer ou à
un Sidonien le désert, car leur travail est différent »[25].
Mais tout en lui disant qu’il « manque de jugement » pour construire
un bateau, ils ne se moquent jamais des talents de leur frère comme
chasseur ni ne le traitent de novice dans le désert. Le fait qu’il
apporte de chez lui un excellent arc d’acier et qu’il sait utiliser
cette arme difficile à manier montre que Néphi a beaucoup chassé dans
sa courte vie.
Léhi a des liens puissants avec le désert dans sa culture familiale. Il
y a deux mille six cents ans, les Juifs se sentaient beaucoup plus proches
des peuples du désert que ce ne serait le cas plus tard. « Nous nous
rendons compte, dit Montgomery, qu’Israël avait le visage tourné vers
ces régions que nous appelons le Désert, et que c’était là son
voisin le plus proche. » Les Juifs eux-mêmes étaient, à l’origine,
des gens du désert, et ils ne l’oublièrent jamais[26]: «
Cette infiltration constante de nomades du désert continue toujours... Il
n’y a pas de barrière de race ou de langue, de caste ou de religion »
entre eux et leurs cousins du désert[27]. On nous
a souvent dit que les patriarches d’autrefois étaient des bédouins
errants, quoique loin d’être barbares[28] ; leur langue était celle des
gens du désert dont beaucoup de mots sont aujourd’hui encore plus
proches de l’hébreu que de l’arabe moderne[29]. À une
période aussi récente que 2000 av. J.-C., l’hébreu et l’arabe n’étaient
pas encore issus « de ce qui était essentiellement une langue commune,
que l’on comprenait de l’océan Indien au Taurus et du Zagros à la
frontière de l’Égypte.Cette langue commune (à l’exclusion de
l’akkadien…) était aussi homogène que l’arabe il y a mille ans[30]. » Une
homogénéité curieuse et persistante de culture et de langue a caractérisé
à toutes les époques les populations du Proche-Orient, de sorte que
Margoliouth a pu affirmer que « un Sabéen (Arabe du sud) n’aurait en
fait trouvé que peu de choses pour l’intriguer dans le premier verset
de la Genèse[31]. » «
Les Hébreux sont demeurés Arabes », tel est le verdict d’une autorité
moderne. « Leur littérature... dans ses formes écrites est de forme et
de type arabe[32]. » Il
n’est pas surprenant que le professeur Margoliouth prétende que la
langue arabe semble détenir « la clef de toutes les serrures » dans
l’étude de l’Ancien Testament.
Ces dernières années, on a eu de plus en plus tendance à assimiler
l’hébreu à l’arabe, et Guillaume conclut l’étude la plus récente
sur ce sujet en affirmant que les deux noms sont en réalité des formes
d’un original commun, tous deux désignant « les fils d’Eber[33] ». Le
nom Arabe n’est pas censé désigner une race, une tribu ou une nation
particulière et, selon Albright, « il n’est pas fait de distinction
tranchée entre Hébreux, Araméens et Arabes à l’époque des
patriarches[34] », mais
le mot désigne simplement un mode de vie, et les Juifs l’appliquaient
à ceux de leurs propres parents qui restèrent en arrière dans le désert
lorsqu’ils se furent eux-mêmes installés à la ville et à la campagne[35].
Il y a un lien intéressant entre Israël et les Arabes qu’il ne faut
pas perdre de vue puisqu’il s’applique d’une manière directe au
Livre de Mormon. Nous pensons à ces généalogies hébraïques dans
lesquelles « la nomenclature est en grande partie non hébraïque, avec
des formations antiques étranges en -an, -on, et dans certains cas
d’origine arabe particulière[36] ».
Selon Albright, parlant des lieux mentionnés dans les documents égyptiens,
« la perte de la désinence -on est très courante dans les noms de lieux
palestiniens[37] ». On
peut se souvenir d’autant de noms de lieux du Livre de Mormon que l’on
veut: Emron, Heshlon, Jashon, Moron, etc., qui ont conservé ce -on archaïque,
révélant un conservatisme désuet chez le peuple de Léhi, et surtout
des liens avec les peuples du désert.
Or de toutes les tribus d’Israël, Manassé était celle qui vivait le
plus loin dans le désert, entrait le plus souvent en contact avec les
Arabes, se mariait le plus fréquemment avec eux, et en même temps avait
les liens traditionnels les plus intimes avec l’Égypte[38]. Et Léhi
appartenait à la tribu de Manassé (Alma 10:3). L’importance du
nom d’Ammon dans le Livre de Mormon a peut-être quelque chose à voir
avec le fait qu’Ammon était le plus proche voisin de Manassé et se
battait souvent contre lui dans les déserts à l’est du Jourdain; en même
temps, un lien préhistorique avec l’Ammon d’Égypte n’est pas du
tout hors de question[39]. La
nature semi-nomade de Manassé pourrait expliquer pourquoi Léhi semble ne
pas être en contact avec les choses de Jérusalem. Pour la première
fois, il « découvrit » (1 Néphi 5:16) dans des documents conservés
chez Laban qu’il était descendant direct de Joseph. Pourquoi ne
l’avait-il pas toujours su? Néphi parle toujours des « Juifs de Jérusalem
» (1 Néphi 2:13) avec un détachement curieux, et personne dans 1 Néphi
ne les appelle jamais « le peuple » ou « notre peuple », mais toujours
du titre tout à fait impersonnel de « Juifs ». Il est intéressant,
dans cet ordre d’idées, de savoir que les lettres d’Éléphantine ne
parlent que de Juifs et d’Araméens, jamais d’Israélites[40].
Non seulement Néphi et Léhi font preuve d’une froideur marquée à
l’égard du sujet de la loyauté tribale, mais tous deux protestent également
en disant que la tribu n’est pas un facteur décisif dans le salut, que
les mêmes bénédictions sont accessibles à tous les hommes, à toutes
les époques et dans toutes les parties du monde (1 Néphi 10:17-22), que
« le Seigneur estime toute chair de la même manière » (1 Néphi
17:35); qu’un peuple arbitrairement « élu », cela n’existe pas. (1
Néphi 17:37-40). Ceci forme un contraste frappant avec le chauvinisme
farouche des Juifs de Jérusalem et cadre avec le cosmopolitisme prononcé
de Léhi dans d’autres choses. Léhi, comme Moïse et son propre ancêtre,
Joseph, était un homme à trois cultures, étant instruit non seulement
dans « la science des Juifs et le langage des Égyptiens » (1 Néphi
1:2), mais également dans la vie du désert[41]. « Il y
a une couleur et une ambiance propres à la vie biblique, dit le
professeur Montgomery, qui lui donnent son ton spécial... et cette
particularité vient des étendues et de la mobilité de la vie dans ce
que nous appelons l’Arabie[42]. » La
culture dualiste de l’Égypte et d’Israël aurait été impossible
s’il n’y avait eu le lien formé par l’indispensable Arabe, tout
comme le commerce entre les deux pays aurait été impensable sans le Bédouin
pour guider leurs caravanes dans ses déserts. Sans l’aimable
collaboration des Arabes, tout passage dans leurs déserts était un
risque terrible pour ne pas dire hors de question, et l’homme
d’affaires averti était toujours celui qui savait traiter avec les
Arabes, ce qui signifiait être l’un d’eux[43].
La lettre de Lakisch n° 6, en dénonçant le prophète Jérémie parce
qu’il répandait le défaitisme tant à la campagne qu’à la ville,
montre que Léhi, partisan du prophète, aurait pu être actif dans
n’importe laquelle de ces régions du « pays de Jérusalem » (1 Néphi
3:10). Même la réflexion que Léhi avait « demeuré toute sa vie à Jérusalem
» n’aurait jamais été faite par ou pour des gens qui ne penseraient
pas à vivre ailleurs, et une demeure « à Jérusalem » serait une aide
plutôt qu’un obstacle à de grands voyages[44], car «
le désert de Judée est une longue projection vers le nord des déserts
arabes jusqu’aux portes de Jérusalem[45]. »
L’ancêtre proverbial des Arabes est Ismaël.
C’est un des rares noms de l’Ancien Testament qui soit également
chez lui dans l’Arabie ancienne[46]. Sa
patrie traditionnelle était le Tih, le désert qui sépare la Palestine
de l’Égypte, et son peuple hantait les « frontières » entre le désert
et la ville[47] ; on le
considérait comme le fils légitime d’Abraham et d’une mère égyptienne.
Ce n’était pas un nom de bon augure, car l’ange avait promis à sa mère:
« ... il sera comme un âne sauvage; sa main sera contre tous, et la main
de tous sera contre lui[48] », et
il y a donc beaucoup de chances pour que quelqu’un qui portait son nom eût
de bonnes raisons familiales pour le faire, et dans Ismaël, l’ami de Léhi,
nous avons certainement un homme du désert. Léhi, devant affronter la
perspective d’un long voyage dans le désert, fit chercher Ismaël,
lequel suivit promptement dans le désert avec une grande compagnie; cela
signifie qu’il ne devait pas être moins habile à se déplacer que Léhi
lui-même. Ce qui est intéressant, c’est que Néphi considère la présence
d’Ismaël comme tout à fait naturelle (contrairement à celle de
Zoram), ne se donnant pas la peine d’expliquer qui il est, ni ce qu’il
vient faire dans l’histoire. Le fait d’aller le chercher lui semble être
la chose la plus naturelle du monde, aussi bien que le mariage de ses
filles avec les fils de Léhi. Étant donné qu’il a toujours été de
coutume parmi les peuples du désert qu’un homme épouse la fille de son
oncle paternel (bint ‘ammi), il est difficile d’éviter l’impression
que Léhi et Ismaël étaient apparentés[49].
Il y a une association remarquable entre les noms de Léhi et d’Ismaël,
qui les rattache tous deux au désert du sud, où se trouvait le lieu de
naissance légendaire et le sanctuaire central d’Ismaël en un endroit
appelé Be’er Lehai-ro’i[50].
Wellhausen rendait ce nom par « source de la mâchoire du bœuf sauvage[51] », mais
Paul Haupt a montré que Léhi (car c’est ainsi qu’il lit le nom) ne
signifie pas « mâchoire » mais « joue »[52], ce qui
laisse malgré tout incertaine la signification de cet étrange composé.
Il y a néanmoins une chose qui est sûre, c’est que Léhi est un nom de
personne. Jusqu’à récemment, ce nom était tout à fait inconnu, sauf
comme nom de lieu, mais maintenant il est apparu à Eilath et ailleurs
dans le sud sous une forme que Nelson Glueck a identifiée avec le nom
Lahai qui « apparaît très fréquemment soit comme élément d’un nom
composé, soit comme nom séparé d’une divinité ou d’une personne,
en particulier dans les textes minéens, thamudiques et arabes[53] ». Il y
a une Beit Lahi, « Maison de Lahi » parmi les noms de lieu antiques de la campagne
arabe qui entoure Gaza, mais la signification du nom a ici été perdue[54]. Le
moins que l’on puisse en dire, c’est que le nom Léhi est tout à fait
chez lui parmi le peuple du désert et autant que nous le sachions, nulle
part ailleurs.
Le nom Lémuel n’est pas un nom hébreu conventionnel, car on ne le
trouve que dans un seul chapitre de l’Ancien Testament (Proverbes
31:1-4) où il est communément considéré comme une substitution poétique
assez mystérieuse à Salomon.Cependant, comme Léhi, il est tout à fait
chez lui dans le désert du sud, où un texte édomite d’un « endroit
occupé par des tribus descendues d’Ismaël » porte le titre: «
Paroles de Lémuel, roi de Massa ». Ces personnes, quoique parlant une
langue qui était presque arabe, se trouvaient cependant bien dans la sphère
de la religion juive, car « nous n’avons nulle part la moindre preuve
que les Édomites aient utilisé un autre nom particulier pour leur
divinité » que « Yahvé, Dieu des Hébreux[55] ».
Le seul exemple du nom de Laman que l’on trouve quelque part, à la
connaissance de l’auteur, est son attribution à un antique mukam, ou
lieu sacré, en Palestine. La plupart de ces mukams sont de date inconnue,
et beaucoup d’entre eux de date préhistorique. En Israël, seule la
tribu de Manassé en construisait[56]. C’est
une coïncidence frappante que Conder ait vu dans le nom Leimun, comme il
le rend (les voyelles doivent être fournies en devinant), une corruption
possible du nom Lémuel, mettant ainsi ces deux noms, si étroitement
associés dans le Livre de Mormon, dans le rapport le plus intime
possible, et ce, dans le seul cas où apparaît le nom Laman[57]. Un nom
bien plus populaire, chez les Arabes comme chez les Néphites, était le
nom Alma, qui peut signifier un jeune homme, une cotte de mailles, une
montagne ou un signe[58]. Si Sam
est un nom parfaitement égyptien c’est aussi la forme arabe normale de
Sem, fils de Noé.
Il faut remarquer ici que l’archéologie a tout à fait démontré que
les Israélites, à l’époque comme maintenant, ne voyaient pas le
moindre inconvénient à donner à leurs enfants des noms qui n’étaient
pas juifs, même si ces noms avaient un relent de paganisme[59]. On
pourrait même, si on voulait faire quelques conjectures, découvrir
quelque chose de l’histoire personnelle de Léhi dans les noms qu’il
donna à ses fils. Les deux premiers ont des noms arabes – ne
rappelleraient-ils pas ses premiers temps dans le commerce caravanier? Les
deux suivants ont des noms égyptiens, et effectivement ils sont nés à
l’époque de sa prospérité. Les deux derniers, nés au milieu des
tribulations du désert, seront appelés, avec l’humilité requise,
Jacob et Joseph. Que les noms des quatre premiers aient eu ou non pour
but, comme c’était certainement le cas pour les noms des deux derniers
fils (2 Néphi 2:1; 3:1) de rappeler les circonstances dans lesquelles ils
sont nés, les noms sont certainement une indication frappante de leur
triple héritage.
[1] On peut trouver les noms égyptiens
dans Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, Glückstadt,
Augustin, 1935 ; Jens D. C. Lieblein, Dictionnaire des noms Hiéroglyphiques,
Christiania, Brôgger & Christie, 1871 ; J. A. Knudtzon, Die
El-Amarna-Tafeln, Leipzig, Hinrich, 1915, réimprimé Aalen,
Zeller, 1964, 2 :1555-83 ; et un peu partolut dans le JEA.
[2] Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, 2 :1561.
[3] Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, p. 412,
lignes 8 et 9.
[4] Id.,
p. 252, ligne 15.
[5] Wilhelrn
Spiegelberg, « The God Panepi », JEA 12 (1926), p. 35.
[6] Alan
H. Gardiner, Egyptian Grammar, Londres, Oxford University Press, 1950,
p. 437.
[7] Hugh W. Nibley, « The Book of
Mormon as a Mirror of the East », IE 51, 1948, p. 249. En 1948 avait été dit ce qui suit : « Il ne
faut pas un grand effort d’imagination pour détecter une sorte de
parallélisme entre les deux courtes listes. Mais n’usons-nous pas
d’une violence injustifiée lorsque nous prenons simplement les noms
au hasard et les plaçons côte à côte ? C’est justement ce
qui est le plus remarquable ; nous avons effectivement pris les
noms au hasard et nous avions le Proche-Orient tout entier dans lequel
nous pouvions puiser et les noms égyptiens ne prédominaient pas dans
les listes que nous avions. Et cependant les seuls noms de l’Ancien
Monde qui correspondent à ceux de l’épisode du Livre de Mormon
viennent tous d’Égypte, que dis-je, d’une partie bien déterminée
de l’Égypte, dans l’extrême sud où fleurissait une colonie
juive depuis une date indéterminée, mais au moins depuis le milieu
du septième siècle. Mieux encore, tous ces noms appartiennent aux
dynasties récentes, d’après le déclin. Le Livre de Mormon nous
dit que Léhi était un riche marchand qui, bien qu’il eût demeuré
toute sa vie à Jérusalem, avait reçu une instruction et une culture
égyptiennes qu’il s’efforçait de transmettre à ses enfants. Le
livre fait constamment allusion à la double culture du peuple de Léhi :
hébreu dans l’âme, mais fier de son héritage égyptien. ‘La
civilisation égyptienne était une civilisation qu’on admirait et
qu’on imitait’, écrit Harry R. H. Hall, en parlant du pays et de
l’époque de Léhi. Les seuls noms non hébraïques à ressortir
chez les Néphites devraient, d’après le Livre de Mormon lui-même,
être égyptiens, et c’est le cas. « Après avoir traité des
noms de Sam et d’Ammon, comme dans le texte ci-dessus, l’article
de 1948 concluait : « Pour en revenir à notre question :
Qu’est-ce que Joseph Smith, le traducteur du Livre de Mormon, savait
de l’Ancien Monde ? Ce qui semble certain, c’est qu’il
connaissait :
(1) Un certain nombre de noms
typiquement égyptiens, des mots à consonance étrange, ne
ressemblant en aucune façon à l’hébreu ni à aucune autre langue
connue du monde du temps de Joseph Smith.
(2) Il connaissait le genre
d’intrigue ou de décor où ces noms figureraient dans l’Ancien
Monde et semble tout à fait à l’aise sur la scène égyptienne.
(3)
Il donne une image claire et correcte des relations culturelles entre
l’Égypte et Israël, en soulignant dûment leur nature
essentiellement commerciale, dans la description remarquablement
convaincante de Léhi, prince marchand typique du 7e s. av. J.-C. Le
tableau de la vie dans l’Orient antique, que le Livre de Mormon nous
permet de reconstituer, est d’autant plus étonnant, quand on pense
à la conception d’un Orient des mille-et-une-nuits dont se
bourraient le crâne même les meilleurs érudits à l’époque où
le livre a paru. Le domaine tout entier des noms du Livre de Mormon
attend encore l’étude soigneuse qu’il mérite, le but de
l’esquisse actuelle étant de simplement indiquer que pareille étude
se révélera être tout sauf une impasse. Comme exemple final de la
validité de cette affirmation, nous citons un principe énoncé par
Albright : « La perte de la désinence ‘on’ est très
courante dans les noms de lieu palestiniens. « William F. Albright, The
Vocalization of the Egyptian Syllabic Orthography, New Haven,
American Oriental Society, 1934, 10 p.12. C’est une terminaison qui
serait conservée en égyptien ou en égyptien ‘réformé’, et
c’est ainsi que nous avons, dans le Livre de Mormon, des noms de
lieu tels que : Emron, Heshlon, Jashon, Moron, Morianton, etc. Ce
n’est pas un mince exploit, comme cela a été démontré dans
Harold Lundstrom, ‘Original
Words of the Book of Mormon,’ IE 51, février 1948, p. 85, ne
serait-ce que de sortir d’on ne sait où tout un tas de noms étranges
et originaux. Mais que dire de l’homme qui a trouvé ceux qu’il
fallait ?
[8] William
F. Albright, « A Brief History of Judah from the Days of Josiah to
Alexander the Great, » BA 9, février 1946, pp. 4-5.
[9] E.
C. Briggs, Saints Herald, 21 juin 1884, pp. 396-97.
[10] William
F. Albright,
« King Joiachim in Exile
», Bibl. Archaologist 5, décembre 1942, p. 51.
[11] Harry Torczyner, The Lachish
Letters, Londres, Oxford University Press, 1938, p. 198. Nous suivons l’orthographe utilisée dans le
texte de Torczyner plutôt que les translittérations de sa liste.
[12] R. A. Stewart Macalister,
« The Craftsmen’s
Guild of the Tribe of Judah », PEFQ, 1905, p. 333.
[13] Ephraïm A. Speiser, «
Introduction to Hurrian », dans Annual of Am. Schools of Or. Research
20, 1940, p. 216 (index). Mais Jens D. C. Lieblein, Handel und Schiffahrt am rothen Meere in
alten Zeiten, Leipzig, Christiania, 1886,
réimprimé Amsterdam, Meridian, 1971, pp. 143-44, trouve le nom Anti dans
l’extrême sud, autour de la mer Rouge.
[14] On trouve d’autres
mentions de noms égypto-hittites dans Sidney Smith, «
Kizzuwadna, » JEA 10, 1924, p. 108 ; Anton L. Mayer & John
Garstang, « Kizzuwadna and Other Hittite States, » JEA Il, 1925, pp.
24 (Cadyanda), 26 (Kurnani) ; Gerald A. Wainwright, « Keftiu, » JEA
17, 1931, pp. 29, 43 (Sandon), 35, 38, 40 (Achish).
[15] Ernil O. Forrer, « The
Hittites in Palestine », PEFQ, 1937, p. 100.
[16] Robert
H. Pfeiffer, « Hebrews and Greeks Before Alexander », JBL 56, 1937,
pp. 91-95, 101 ; William F. Albright, « A Colony of Cretan
Mercenaries on the Coast of the Negeb », JPOS 1, l921, pp. 187-94 ;
Joseph G. Milne, « Trade Between Greece and Egypt Before Alexander
the Great », JEA 25, 1939, p. 178 ; F. B. Welch, « The Influence of
the Aegean Civilization on South Palestine », PEFQ, 1900, p. 342,50. À Tel-el-Hesy, juste à l’ouest de Lakisch, «
l’influence grecque commence en 700 (av. J.-C.) et continue
jusqu’au sommet de la ville », William M. F. Petrie, dans PEFQ,
1890, p. 235. Nelson Glueck, « Ostraca from Elath », BASOR 80, décembre
1940, p. 3.
[17] Eduard Meyer, Geschichte
des Altertums 2e éd., Stuttgart, Cotta, 1928, vol. 2, 1e partie,
p. 553.
[18] Joseph Offord, « Further
Illustrations of the Elephantine Aramaic Jewish Papyri », PEFQ, 1917,
p. 127.
[19] William
F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 1942, p. 160.
[20] David S. Margoliouth, The
Relations between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam,
Schweich Lectures, Londres, Oxford University Press, 1924, p. 13.
[21] Harry
R. H. Hall, « The Eclipse of Egypt », Cambridge Ancient History,
New York, Macmillan, 1925, 3:256, 269, 292.
[22] Meyer,
Geschichte des Altertums, Stuttgart, Cotta, 1909, vol. 1, 2e
partie, p. 156; Hall, « The Eclipse of Egypt », 256.
[23] James
A. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphie, University
of Pennsylvania Press, 1934, p. 52 ; la deuxième citation
est p. 28.
[24] Le
risque qu’il y a à se préparer pour une expédition dans la ville
est évident, puisque la curiosité que cela suscite soulève des
questions dangereuses et peut avoir des effets considérables. Voir,
d’une manière générale, Bertram Thomas, Arabia Felix, New
York, Scribner, 1932, p. 36; on trouvera un récit de préparatifs et
d’activités au « camp de base » dans idem, 112-13; Harry S. J. B. Philby,
The Empty Quarter, New York, Holt, 1933, pp. 9-13.
[25] Arthur
E. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., Oxford,
Clarendon, 1923, p. 226 (col. 14, 1, 208).
[26] Il y a,
à ce jour, en Palestine, des fermiers qui passent une grande partie
de leur temps à vivre sous tente dans le désert. Notre ami, Mose
Kader, en faisait partie. Voir
George E. Kirk, « The Negev or the Southem Desert of Palestine »,
PEFQ, 1941, p. 60. D’autre part, H. H. Kitchener, « Major
Kitchener’s Report » PEFQ, 1884, p. 206, a remarqué que des Arabes
vivant sous la tente, de vrais bédouins, semaient de l’orge dans la
campagne autour de Gaza. Doughty écrit à propos des Arabes moahib:
« Leur moisson terminée, ils démontent le hameau de tentes et
s’en vont avec leur bétail errer comme des nomades. » Charles
M. Doughty, Travels in Arabian Deserts, Londres, Cape, 1926,
1:276. Carl
R. Raswan, Drinkers of the Wind, New York, Creative Age Press,
1942, décrit dans le détail la facilité des allées et venues entre
le désert et la ville, de riches Arabes de la ville partant souvent passer une saison ou
quelques heures dans les sables. Voir aussi J. W. Crowfoot et Grace M.
Crowfoot, « The Ivories from Samaria », PEFQ, 1933, p. 24.
Quelqu’un, qui était presque le contemporain de Léhi, était « le
chef arabe qui campait dans la périphérie de Jérusalem à l’époque
de Néhémie et portait le bon nom arabe du nord de Geshem Jusham ». Nabih
A. Faris, éd., The Arab Heritage, New Jersey, Princeton
University Press, 1944, p. 35.
[27] Montgomery,
Arabia and the Bible, p. 23 ; la citation de Montgomery
plus haut dans le paragraphe se trouve p. 185 ; voir aussi Eduard
Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, Halle, 1906, réimprimé
à Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967, pp. 209-561.
[28] Margoliouth,
The Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam,
p. 25; Montgomery, Arabia and the Bible, p. 186; Philip J.
Baldensperger, « The Immovable East » PEFQ, 1922, p. 163, et 1926, pp. 93-97. Cela
ne veut pas dire que les patriarches
étaient des « primitifs »; car « nous sommes en train
d’apprendre que les immigrants n’étaient pas des nomades à l’état
sauvage ou semi-sauvage, mais des colons emportant dans leur nouvelle
patrie le souvenir d’une organisation politique développée, avec
des usages et des pratiques et ayant une histoire derrière eux. » Margoliouth, The
Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam, p.
25. Voir aussi, Edouard P. Dhorme, « Le Pays de Job », RB 8, 1911,
102,7; George A. Barton, « The Original Home of the Story of Job »,
JBL 31, 1912, p. 63.
[29] Baldensperger,
« The Immovable East », PEFQ, 1923, p. 176.
[30] William
F. Albright, « Recent Progress in North-Canaanite Research » BASOR
70, avril 1938, p. 21.
[31] Margoliouth,
The Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam, pp.
5, 8, Theodor Nöldeke, Die semititischen Sprachen, Leipzig,
Tauchnitz, 1899, pp. 52, 57; Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme,
pp. 305-7.
[32] Montgomery,
Arabia and the Bible, p. 53, citant Duncan B. MacDonald, The
Hebrew Literary Genius, Princeton, Princeton University Press,
1933, pp. 26-27.
[33] «
Je pense qu’il ne fait aucun doute que les Hébreux étaient ce que
nous devrions appeler des Arabes, en utilisant le terme dans son sens
le plus large. » Alfred
Guillaume « The Habiru, the Hebrews and the Arabs » PEFQ, 1946, pp. 65-67.
[34] Albright,
« Recent Progress in North-Canaanite Research », p. 21.
[35] Guillaume,
« The Habiru, the Hebrews, and the Arabs », pp. 64-85 ; Stephen
L. Caiger, Bible and Spade, Londres, Oxford University Press,
1936, pp. 84-85.
[36] Montgomery,
Arabia and the Bible, p.
47.
[37] William
F. Albright, Vocalization of Egyptian Syllabic Orthography, New
Haven, American Oriental Society, 1934, p. 50 (ch. 10, C, ligne 12).
[38] Abraham
Bergman, « The Israelite Tribe of Half-Manasseh », JPOS 16, 1936,
pp. 225, 228, 249; Moses H. Segal, « The Settlement of Manasseh East
of the Jordan » PEFQ, 1918, p. 124.
[39] On a émis
l’hypothèse qu’Ammon, comme son concurrent Aton, était, à
l’origine, de Syrie-Palestine, théorie qui ne manque pas de mérite,
surtout du fait que Wainwright a montré les relations palestiniennes
pré-historiques de Min de Coptos (l’Amon original). Gerald
A. Wainwright, « The Emblem of Min », JEA 17, 1931, pp. 185-95; et
Gerald A. Wainwright, « Letopolis », JEA 18, 1932, pp. 161-63.
[40] Albright,
Archaeology and the Religion of Israel, p. 171.
[41] Dans la
version pour le magazine, de 1950, Nibley note: « Cette culture
tripolaire est un phénomène classique dans cette partie du monde où
les caravanes d’Égypte et d’Israël se croisent, guidées au
milieu des sables par ces hommes du désert qui étaient les intermédiaires
immémoriaux des deux civilisations. » Hugh
W. Nibley, « Lehi in the Desert » , IE 53, 1950, p. 155. « Le
caractère naturel des tribus bédouines a toujours été d’agir
comme une sorte de peuple intermédiaire, sans politique fixe. » Baldensperger,
« The Immovable East », PEFQ, 1925, p. 85. Même
aujourd’hui, les bédouins « ‘Arishiye(t) sur la frontière égyptienne
transportent des marchandises par voie de terre de Gaza en Égypte et
vice-versa. Ils constituent une classe intermédiaire curieuse; ils
pratiquent le commerce et l’agriculture et sont éleveurs de
chameaux. » Id.,
PEFQ, 1922, p. 161. Cf. John L. Burckhardt, Notes on the Bedouins
and Wahabys, Londres, Colburn & Bently, 1831, pp. 1-9, 26-27,
30-31, 275-76. Au 6e s. av. J.-C., les Arabes prirent
Gaza, le point d’ancrage septentrional de la route commerciale égyptienne.
Hérodote,
Histoires III 5; 111, 7; 111, 91; William F. Albright, « Egypt and
the Early History of the Negeb », JPOS 4, 1924, p. 130. Les marchands arabes, enrichis par le commerce
tripolaire, fondèrent l’État nabatéen. Kirk, « The Negev or the
Southern Desert of Palestine », p. 62. En tout temps, le commerce
palestino-égyptien a été la source principale de richesse pour ces
gens, pour ne pas dire la seule. Taufik Canaan, « Byzantine
Caravan Routes in the Negeb », JPOS 2, 1922, p. 144. Sur l’antiquité
du commerce tripolaire, voir Lieblein, Handel und Schiffahrt auf
dem rothen Meere in alten Zeiten, 76, pp. 134-36; William J. T.
Phythian-Adams, « Israel in the Arabah », PEFQ, 1941, pp. 61-62,
Stewart Perowne, « Note on I Kings, Chapter X, 1-130 », PEFQ 1939,
p. 201. Albright, « Egypt and the Early History of the Negeb », pp.
130-32.
[42] Montgomery,
Arabia and the Bible, p. 5.
[43] Baldensperger,
« The Immovable East », PEFQ, 1925, p. 85 et 1922, p. 161;
Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys 1:9, 26-27,
30-31; Kirk, « The Negev or the Southern Desert of Palestine », p.
62; Canaan, « Byzantine Caravan Routes in the Negeb », p. 144;
Phythian-Adams, « Israel in the Arabah », PEFQ, 1933, p. 143;
Perowne, « Notes on I Kings, Chapter X, 1- 13 », p. 201; Albright, Egypt
and the Early History of the Negeb, pp. 131-41. À
propos des attaches existant entre les Bédouins, les marchands et les
fermiers de Palestine et d’Égypte, Baldensperger dit: « Quinconque
se donne la peine d’étudier et de comprendre ces attaches verra
qu’il est relativement facile de prendre des arrangements avec les
tribus du désert, si lointaines qu’elles soient. » Charles Warren, « Notes on
Arabia Petraea and the Country Lying between Egypt and Palestine »,
PEFQ, 1887, p. 45, n. 23. Dès le début, les Juifs
furent forcés, de par leur position géographique, de traiter avec
les Arabes et de se livrer au commerce, voir Elias Auerbach, Wüste
und Gelobtes Land, 2 vols. Berlin,
Schocken, 1932.
[44] Ainsi,
« les Arabes du sud, bien qu’installés dans leurs bases, étaient
des voyageurs et des marchands indomptables. » Guillaume, « The Habiru,
the Hebrews, and the Arabs », p. 67. Il n’y a rien qui empêche Léhi,
quoique installé dans sa base, d’être un voyageur indomptable, à
moins d’interpréter 1 Néphi 1:4 comme voulant dire qu’il
n’avait jamais mis les pieds hors de la ville depuis le jour de sa
naissance, ce qui est une absurdité flagrante.
[45] Montgomery,
Arabia and the Bible, p. 12.
[46] Margoliouth,
The Relations between Arabs and Israel Prior to the Rise of Islam,
p. 29; Guillaume, “The Habiru the Hebrews, and the Arabs,’’ pp.
84-85.
[47] Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, p. 302.
[48] John
Zeller, « The Bedawin » PEFQ, 1901, p. 198.
[49] Le
professeur Sperry a attiré l’attention de l’auteur sur une déclaration
attribuée à Joseph Smith, disant qu’Ismaël était d’Ephraïm et
que ses fils avaient épousé les filles de Léhi. G. D. Watt & J.
V. Long, reporters, Journal of Discourses, Liverpool,
Cannon/Londres, LDS Book Depot, 1862; réimprimé à Los Angeles,
Gartner, 1956, 23:184, commenté dans Sidney B. Sperry, « Did Father
Lehi Have Daughters Who Married the Sons of lshmael ? » IE 55,
septembre 1952, p. 642. Éphraïm, comme Manassé, était du désert.
[50] Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbarstämme, pp. 322-23.
[51] Id.,
p. 322.
[52] Paul
Haupt, “Heb. lehi, cheek, and lo, jaw”, JBL 33, 1914, pp. 290-95.
Cf. Juges 15:17, 19.
[53] Glueck,
« Ostraca from Elath », pp. 5-6, fig. 2.
[54] Edward
1-1. Palmer, « Arabic and English Name Lists », dans Survey of
Western Palestine,
Londres, Palestinian Exploration Fund, 1881, 8:358.
[55] Eliezer ben Yahuda, « The
Edomite Language », JPOS 1, 1921, pp. 113-15; Montgomery, Archaeology
and the Bible, p. 171, note qu’il y avait une tribu arabe appelée
Massa, mais « il n’y a pas de roi hébreu appelé Lémuel ».
[56] C.
Clermont-Ganneau, « The Arabs in Palestine », dans Survey of
Western Palestine, Special Papers, Londres, Palestine Exploration
Fund, 1881, 4:325.
[57] Claude
R. Conder, « Moslem Mukams », dans Survey of Western Palestine,
Special Papers, Londres, Palestine Exploration Fund, 1881, 4:272.
[58] PaImer,
« Arabic and English Name Lists », pp. 17, 40, 66.
[59] Adolf Reifenberg, « A Hebrew Shekel of the Fifth Century B.C. », PEFQ, 1943, p. 102; Albright, Archaeology and the Religion of Israel, p. 113. Parmi les enfants des contemporains de Léhi qui s’enfuirent en Egypte, on peut suspecter des noms perses, babyloniens et même arabes, même s’ils demeurèrent de bons Juifs. Samuel A. Cook, « The Jews of Syene in the Fifth Century B.C. », PEFQ, 1907, pp. 68-73.
l Accueil l
Écritures l Livres
l Magazines l Études
l Médias l Art
l