
CHAPITRE SIX : Léhi le vainqueur
Un mot sur les plaques
Nous avons vu comment le gouverneur de Byblos, pour
marquer un point en marchandant avec Wenamon, fit apporter ses documents
et ses récits de famille et les fit lire devant lui. Dans les tablettes
d’Amarna, le Rabu d’une ville palestinienne écrit à un prince
voisin: « Mais maintenant voici [notez le style du Livre de Mormon], le
roi fait en sorte que sa ville fidèle échappe à sa main; que le roi
cherche dans les tablettes qui sont gardées dans la maison de son père
et apprenne si celui qui gouverne Gubla a été son serviteur fidèle[1].
» Ici, comme à Byblos, les documents étaient conservés dans la maison
de la famille régnante; même dans la Rome lointaine, à l’époque de Léhi,
les documents à partir desquels les annales ultérieures furent composées
semblent avoir été conservés sur des tablettes chez les familles
dirigeantes[2]. À cette époque, la pratique
semble avoir été générale autour de la Méditerranée. Lorsque
l’ouvrage avait une importance réelle, on se servait de cuivre ou de
bronze ou même de métal plus précieux au lieu des tablettes ordinaires
de bois, de plomb ou d’argile. Une des découvertes les plus récentes
de ce genre en Palestine est « une plaque de cuivre ou de bronze »
en hébreu, datant du douzième siècle av. J.-C., contenant un message «
de caractère tout à fait séculier et profane, mais « qui dut paraître
suffisamment important pour être gravé sur cette matière durable
quoique ‘peu pratique’ qu’est le métal[3] ». On tenait sur des
plaques d’argent les documents plus précieux comme le célèbre traité
de 1287 entre les rois d’Égypte et les Hittites, et le document royal
des actes de Darius méritait rien moins que l’or, et a fait l’objet
d’une attention considérable de la part des auteurs mormons. Les mystérieux
textes en « égyptien réformé » de Byblos sont sur des plaques de
bronze et la Chronique démotique d’Égypte était tenue, à
l’origine, sur des plaques. Il y a dans Idrisi (1226 apr. J.-C.) un récit
intéressant sur l’ouverture de la tombe de Mykérinos dans la troisième
des trois grandes pyramides. L’auteur rapporte que tout ce que l’on
trouva dans la tombe, ce fut un sarcophage bleu contenant « les restes décomposés
d’un homme, mais pas de trésor, sauf quelques tablettes d’or,
couvertes de caractères dans une langue que personne ne pouvait
comprendre ». Les tablettes furent utilisées pour payer les ouvriers et
l’or qui s’y trouvait valait à peu près deux cents dollars[4].
Nous laissons au lecteur le soin d’imaginer ce qui pouvait être écrit
sur ces plaques d’or qu’un des plus grands des pharaons considérait
apparemment comme le plus grand trésor avec lequel on pouvait
l’enterrer.
Une lumière nouvelle et peut-être significative
concernant les documents sur plaques nous parvient d’une source
inattendue. Récemment un grand nombre de plaques d’or, écrites, perforées
et reliées les unes aux autres par des anneaux de métal sont apparues en
Inde. Nous pouvons prendre comme typiques (sauf qu’elles sont plus étroites
que la plupart) les plaques de Kesarbeda : « l’ensemble se compose
de trois plaques de cuivre reliées par un anneau de cuivre... La circonférence
et le diamètre de l’anneau sont respectivement d’environ vingt centimètres
et cinq centimètres... Les plaques mesurent à peu près vingt centimètres
de long et un demi-centimètre de large chacune. Les coins sont
arrondis... les plaques contiennent à leur droite un trou ayant un diamètre
d’un demi-centimètre pour l’anneau. » Toutes les plaques sont
écrites des deux côtés[5]. La date de ces plaques est
d’environ 324 apr. J.-C. Le contenu, une charte de royauté, donne les
conditions dans lesquelles le pays sera gouverné.
Plus à l’est, mais toujours dans la sphère de la
culture indienne, des plaques écrites du même genre, mais que l’on ne
peut plus lire, sont transmises « de père en fils » comme
talismans anciens d’origine surnaturelle[6],
montrant comment l’idée d’autorité et de caractère sacré reste
attachée aux plaques longtemps après que les hommes ont perdu la capacité
de les lire. Chez les Karens, une plaque de ce genre, formée de deux
sortes de plaques soudées l’une à l’autre, dos à dos, l’une de
cuivre et l’autre apparemment d’or, était en réalité « le talisman
par lequel le chef détenait son pouvoir sur le peuple[7] »,
ce qui signifie que le droit de gouverner le pays dépendait de la
possession de ces plaques, probablement parce qu’en réalité ces
plaques étaient à l’origine une charte royale.
Bien sûr, l’Inde semble très éloignée du monde
culturel de Léhi, et pourtant l’écriture ancienne et moderne de la région
dérivait en réalité des formes araméenne et phénicienne, tirées en
fin de compte de l’égyptien[8].
Puisque l’écriture la plus ancienne connue en Inde (sans compter les
inscriptions préhistoriques de Mohenjo-Daro, etc.) est celle que l’on
trouve sur les plaques, il est au moins probable que l’écriture et les
plaques furent introduites en même temps, et que les gens qui
introduisirent les lettres sémitiques dans la région tenaient leurs
documents sur des plaques rattachées par des anneaux, la forme étant
conservée par les Indiens eux-mêmes dans leurs documents les plus
anciens et les plus sacrés. Le cas des Karens est particulièrement intéressant
parce que ces gens ont montré des affinités culturelles si étonnantes
avec les Juifs que certains observateurs ont même prétendu qu’ils étaient
d’origine juive[9]. S’il en est ainsi, leur
histoire a pu comporter plus d’un parallèle avec celle de Léhi.
Beaucoup de chapitres de la diaspora doivent encore être écrits. Mais ce
que nous voulons faire ressortir ici, c’est que l’on commence à se
rendre compte que la connaissance et l’utilisation des plaques de métal
pour enregistrer des documents importants était une pratique généralisée
dans tout le monde antique. Il ne faudra plus beaucoup de temps pour que
les homme oublient que, du temps de Joseph Smith, le prophète a été
tourné en dérision et ridiculisé plus pour sa description des plaques
que pour toute autre chose.
Néphi
fut très impressionné par l’épée de Laban: « Sa poignée était
d’or pur et son exécution était extrêmement fine, et... sa lame était
de l’acier le plus précieux » ("1 Néphi 4:9). Des épées et des poignards cérémoniels de ce genre
avec des poignées d’or finement ciselé ont été communs au Proche
Orient pendant tous les temps historiques. Beaucoup d’échantillons d’Égypte
et de Babylonie reposent dans nos musées[10], mais il n’en est aucun
qui soit plus célèbre ni plus beau que le splendide poignard d’argent
à la poignée en or pur et du travail le plus fin que l’on a trouvé
sur la personne du jeune roi Toutankhamon[11].
On a même suggéré que ce poignard était l’un des deux qui avaient été
envoyés, bien des années auparavant, par le roi Dushratta de Mitanni au
Pharaon régnant de l’époque comme le plus royal des dons et décrits
dans un document contemporain comme ayant des poignées d’or et des
lames d’acier[12]. Le terme de Néphi « acier
précieux » est intéressant, car de son temps, l’acier réel était
beaucoup plus précieux que l’or, étant sans doute fait de sidérolithe
et de qualité supérieure. Les célèbres lames de Damas, le meilleur
acier que le monde ait jamais vu, étaient toujours, selon Jacob, en sidérolithe
– indication d’une origine très ancienne[13].
Même dans la Palestine moderne, les épées et les poignards ont été «
surtout de fabrication damascène ou égyptienne[14]
». Aujourd’hui encore, on ne voit jamais de prince arabe en vêtement
national sans son « khanjar », le long poignard recourbé en acier de
Damas avec sa splendide poignée d’or. Ces armes cérémonielles sont
souvent des bijoux de famille d’une grande antiquité et d’une immense
valeur. Ainsi donc, à n’importe quelle époque entre la période
d’Amarna (quinzième siècle av. J.-C.) jusqu’à l’époque actuelle,
l’étiquette de l’Orient aristocratique exigeait que Laban portât une
arme semblable à celle que décrit Néphi.
La fin du désert
Dans les
voyages à travers le désert, nous disent les experts, tous les jours –
et c’est ce qui est déprimant – se ressemblent. Pendant des milliers
d’années, le langage du désert est demeuré virtuellement inchangé,
employant les mêmes mots et les mêmes expressions, sans altération, de
siècle en siècle, parce que les choses qu’ils décrivent n’ont
jamais changé. C’est tout à fait à bon droit que Margoliouth utilise
l’épopée des Bani Hilal pour illustrer les migrations des enfants
d’Israël, des milliers d’années avant eux : « Ils n’émigrent pas
au petit bonheur... » mais se font précéder par des éclaireurs et
avant de prendre une quelconque décision, ils prennent grand soin de découvrir
la volonté du ciel par « divers présages et augures ». Ceci vaut
parfaitement pour le peuple de Léhi, dont les jeunes gens partent
constamment en éclaireurs et à la chasse. Quant à apprendre la volonté
du ciel, pas de meilleur instrument que le merveilleux Liahona. Le nom
suggère tant d’interprétations hébraïques et égyptiennes possibles
(c’est, par interprétation, « un compas » Alma 37:18), que toutes les
explications sont bonnes et cela ne nous concerne pas ici, puisque, en
tant que chose miraculeuse, il n’a pas de parallèle dans la vie de tous
les jours. D’autre part, on peut facilement trouver un parallèle de ce
genre au commentaire de Néphi sur la manière merveilleuse dont les
femmes semblaient prospérer malgré le dur mode de vie bédouin (1 Néphi
17:2), car ce phénomène a toujours impressionné les visiteurs chez les
Arabes, où, dit Burton, « entre les extrémités de la férocité et de
la sensibilité, le sexe faible, remédiant à sa grande lacune, la force,
s’élève par le courage, physique aussi bien que moral[15] ».
Néphi n’a
aucune raison de nous donner, dans son histoire extrêmement abrégée, un
récit au jour le jour d’un voyage long et monotone dans le sable ; il
nous a donné, comme nous l’avons vu, une idée générale claire de la
mauvaise humeur, de l’épuisement et du danger qui constituent
l’histoire commune des voyages dans le désert et il n’y a pas
grand-chose à dire de plus que cela.
Mais il ne peut cacher l’excitation et la joie de voir la fin du
voyage.
Après avoir parcouru une énorme distance
dans une direction sud-sud-est ("1
Néphi 16:13, "33), le groupe bifurqua pratiquement en direction de
l’est, à travers le pire de tous les déserts, où ils « [souffrirent]
beaucoup d’afflictions », pour arriver dans un état d’épuisement
presque total à un paradis tout à fait inattendu au bord de la mer. Il y
a un paradis de ce genre dans les montagnes Qara sur la côte méridionale
de l’Arabie. Pour y arriver en se dirigeant « presque dans la
direction de l’est » ("1 Néphi
17:1) à partir de la côte de la mer Rouge, il
faudrait tourner vers l’est au dix-neuvième parallèle. Dans l’Improvement
Era de septembre 1951, l’auteur a publié une carte dans laquelle il
se souciait principalement de faire arriver Léhi à la mer dans le
secteur forestier de l’Hadramaout et aucune autre considération ne
dictait son dessin de la carte. Il avait sottement oublié le fait que le
Dr John A. Widtsoe avait publié dans l’Era, quelques mois
auparavant, ce qui se dit être, et est probablement, une authentique « révélation
à Joseph le voyant », dans laquelle il est dit que la compagnie de Léhi
« voyagea presque vers le sud-sud-est jusqu’au moment où elle arriva
au dix-neuvième degré de latitude nord ; puis presque vers l’est
jusqu’à la mer d’Oman »[16].
Par une coïncidence intéressante, l’itinéraire marqué sur la carte
de l’auteur tournait vers l’est exactement au dix-neuvième parallèle.
Cette correspondance des données venant de deux sources tout à fait différentes
est une forte indication que les deux sont correctes. Le seul autre itinéraire
possible aurait été le long de la côte occidentale de la mer
Rouge depuis le canal de Néchao, et avec un tel itinéraire, on ne peut
tourner vers l’est avant d’avoir dépassé le dixième parallèle, et
alors ce n’est pas la mer d’Oman que l’on trouve, mais l’océan
Indien. Parallèlement à cela, il faut remplir certaines autres
conditions rigoureuses qui ne se vérifient que sur la côte sud de
l’Arabie.
À propos des
monts Qara, qui se trouvent dans ce secteur limité de la côte méridionale
de l’Arabie que Léhi a forcément dû atteindre s’il a tourné vers
l’est au dix-neuvième parallèle, Bertram Thomas, un des rares Européens
qui les ait jamais vues, écrit :
« Quel
endroit merveilleux ! Des montagnes de neuf cents mètres de haut dominant
un océan tropical, leurs pentes tournées vers la mer, veloutées d’une
jungle ondoyante, le dessus parfumé de prairies jaunes vallonnées,
au-delà desquelles les montagnes s’inclinent vers le nord jusqu’à
une steppe de grès rouge... Grande fut ma joie lorsqu’en 1928 je débouchai
sur tout cela à la sortie des déserts arides des régions frontalières
du sud[17]. »
Le capitaine
Thomas (que Lowell Thomas appelle « le plus grand explorateur vivant »)
décrit ensuite les buissons aromatiques de l’endroit, les vallées boisées,
« Ie bord brumeux de la mer lointaine dressé au-delà des montagnes qui
dévalent vers elle », et l’admirable beauté des « scènes sylvestres
» qui se présentaient à la vue tandis qu’il traversait les forêts
luxuriantes vers la mer[18].
Comparez ceci
à la description de Néphi :
Et nous arrivâmes au pays que nous appelâmes Abondance à cause de la grande quantité de ses fruits et aussi de son miel sauvage... et nous vîmes la mer... et en dépit du fait que nous avions souffert beaucoup d’afflictions et beaucoup de difficultés, oui, tellement que nous ne pouvons les écrire toutes, nous fûmes extrêmement réjouis lorsque nous arrivâmes au bord de la mer; et nous appelâmes l’endroit Abondance, à cause de la grande quantité de ses fruits... et... la voix du Seigneur me parvint, disant: Lève-toi et rends-toi sur la montagne... (1 Néphi 17:5-7).
C’est virtuellement
la même scène: les montagnes, les riches forêts avec du bois de
charpente pour les bateaux, la prairie jaune ondoyante, paradis des
abeilles, le spectacle de la mer au-delà, et surtout le joyeux
soulagement au moment de sortir soudain de la « steppe de grès rouge »,
un des pires déserts de la terre. Thomas ne s’intéressait bien sûr
pas à trouver du miel, mais pour ceux qui doivent vivre en permanence
dans le désert, il n’est pas de plus grand trésor que de trouver du
miel, comme le montre bien un grand nombre de racines et de dérivés dans
le vocabulaire arabe[19]. Une description à peu près
semblable pourrait convenir aux montagnes d’Oman plus loin à l’est,
situées au vingt-cinquième parallèle, dont la découverte fut une
grande surprise en 1838[20]. Lorsqu’en 1843 Von Wrede
fit une description enthousiaste des montagnes de l’Hadramaout
auxquelles parvint Léhi, le grand Von Humboldt, et bien sûr après lui
le monde savant tout entier, refusa tout simplement de le croire[21].
Les délicieuses montagnes de Thomas étaient inconnues en Occident
jusqu’à il y a moins de vingt-cinq ans. Bien que « Ies côtes méridionales
d’Arabie aient des ports admirables », elles ne semblent pas avoir été
utilisées, à quelques exceptions possibles près, avant une époque fort
postérieure au temps du Christ[22].
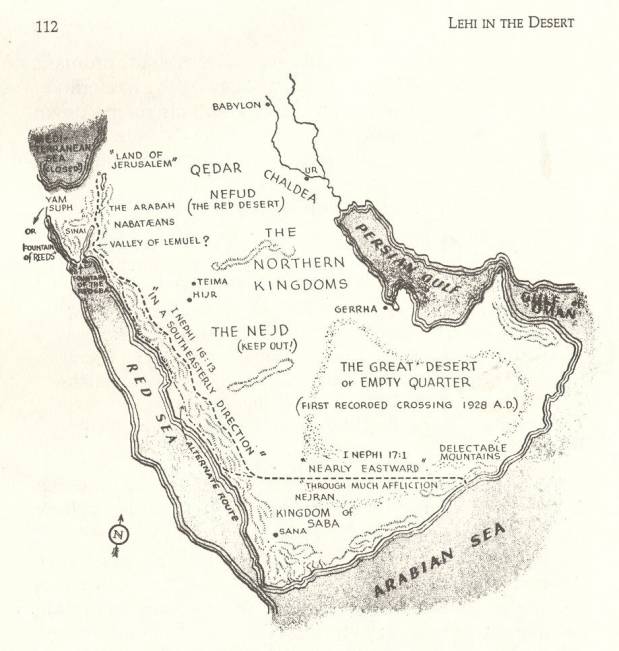
Quand on
regarde le groupe épuisé de Léhi descendre vers les plaisantes vallées
jusqu’à la mer, on est poussé à se dire qu’il a fait un chemin
immense rien que pour construire un bateau. Que le lecteur propose donc un
autre itinéraire. Le meilleur guide sur l’Arabie, à l’époque où le
Livre de Mormon a été écrit, imaginait des forêts et des lacs au
centre de la péninsule, tout en insistant sur le fait que la région côtière
tout entière était « un mur de pierres... aussi nu et désert que
possible; pas un brin d’herbe, pas la moindre tache de verdure » à
trouver[23].
Le Livre de Mormon inverse l’image et nous montre Léhi évitant le cœur
du continent pour découvrir les régions boisées et souriantes de la côte
méridionale. En quel autre endroit aurait-il pu trouver son bois de
charpente sur toute la côte de l’Arabie ? « Il est tout à fait probable,
écrit une autorité moderne, que Salomon dut transporter ses bateaux, ou
le matériel pour les construire, depuis la Méditerranée, car où, sur
les rives de la mer Rouge, pouvait-on trouver du bois de charpente pour
construire des bateaux ?[24] ».
Et par quel
autre itinéraire Léhi aurait-il pu atteindre son heureux rivage ? Au
nord, c’était le territoire ennemi, la Méditerranée était un monde
de ports fermés et de mers fermées, aussi dangereux que du temps de
Wenamon, qui était constamment arrêté par des ennemis et des pirates ;
les déserts à l’est de Jérusalem foisonnaient de tribus hostiles et
sur pied de guerre ; le nord et le centre de l’Arabie étaient les
lieux classiques de pâturage et de combat des Arabes, et à ce point
sillonnés de routes marchandes du temps de Ptolémée « qu’il ne
semble pas rester grand-chose du désert inaccessible… ‘d’une manière
générale Ptolémée ne connaît pas de désert’[25] ».
L’Égypte
n’offrait pas de refuge à quelqu’un que le parti pro-égyptien considérait
comme ennemi. Un seul chemin était libre, le plus dur et le plus sauvage,
à travers les montagnes qui bordent la mer Rouge et puis vers l’est en
traversant l’extension occidentale du terrible « quartier vide » où
le groupe connut tant d’afflictions. Il fallait qu’ils bifurquent vers
l’est quand ils le firent parce que tout le coin sud-ouest de la péninsule
était occupé par le royaume des Sabéens, l’état qui fut probablement
le plus fort, le plus riche et le plus densément peuplé que l’Arabie
ait jamais connu.
Ainsi donc,
aussi long et pénible qu’il fût, l’itinéraire de Léhi se révèle
avoir été en réalité le plus court et le plus sûr, sinon le seul
qu’il aurait pu prendre. C’est sur le rivage de la mer d’Oman que se
termine à proprement parler l’histoire de Léhi dans le Désert. Bien
que ceci n’ait été qu’une narration préliminaire, nous en avons dit
assez pour justifier certaines réflexions en guise de résumé.
Léhi à la
barre des témoins
Nous ne nous
sommes jamais beaucoup intéressé à « prouver » le Livre de Mormon;
pour nous, sa provenance divine a toujours été un article de foi et ses
aspects historiques sont de loin la chose la moins importante chez
lui. Mais « Ie monde » prétend que c’est un faux grossier et stupide,
une falsification éhontée commise par un paysan ignorant qui pouvait à
peine écrire son nom. Il a proféré l’accusation, qu’il la prouve.
Ce devrait être très facile s’il a raison, il suffirait simplement de
feuilleter quelques pages et de mettre le doigt sur d’innombrables
erreurs, puisque l’accusé s’est clairement engagé et n’a pas lésiné
sur les détails. La nature du document qu’il affirme traduire est si
singulière, et les conditions que le document doit remplir sont si spécifiques
et si astreignantes, que son auteur doit certainement être reconnu
coupable au premier coup d’œil s’il ment. D’autre part, si son écrit
montre la moindre tendance à se conformer aux conditions spéciales
prescrites, ses critiques devront donner pas mal d’explications, et
s’il montre une tendance constante à se conformer à ces
conditions difficiles, ses critiques feront faillite. Nous croyons que
cette petite étude, aussi provisoire et limitée qu’elle soit, indique
néanmoins, au-delà de tout doute raisonnable, une tendance de ce genre.
Qu’avons-nous
prouvé ? Simplement que tout ce que le livre de 1 Néphi dit s’être réellement
produit a pu arriver. Non pas que c’est arrivé :
Prouver cela n’est ni nécessaire ni possible. Les événements uniques
de l’histoire ne peuvent jamais être reconstitués avec certitude; mais
les événements caractéristiques apparentés: us et coutumes, rituels,
etc., des choses qui arrivent non pas une seule fois, mais maintes et
maintes fois dans des contextes bien connus, peuvent être l’objet
d’une certitude presque absolue. C’est par conséquent eux, et non pas
les événements particuliers, qui sont les choses les plus difficiles à
contrefaire; quand on veut vérifier
les faux et identifier les documents, c’est bien le contexte général
qui est de première importance. Ce principe est bien illustré dans la
critique de Palgrave par Cheesman.
Bien que les descriptions de Hufhuf par Palgrave soient si remplies d’
« inexactitudes pures et simples » et « d’indiscrétions flagrantes
» qu’elles paraissent être de parfaites inventions, et bien que la
carte que fait Palgrave de Hufhuf soit si pleine d’inexactitudes qu’il
n’a même pas pu l’orienter, Cheesman n’en conclut pas moins que «
Ia description que fait Palgrave de Hufhuf, de ses jardins, de ses
arcades, de ses industries et de son peuple... n’aurait pu être composée
que par un témoin oculaire ». En dépit de toutes ses imperfections,
l’ensemble du tableau présente des objets qui n’auraient pas été
mentionnés s’ils n’avaient pas été vus. « Il n’est que trop
facile, écrit le même auteur, aussi soigneux que l’on soit, de tomber
dans de petites inexactitudes, quand on s’efforce de mettre de la
couleur dans la description que l’on fait d’un pays, et il est encore
plus facile, je m’en suis aperçu, de venir après et de faire remarquer
les erreurs d’un prédécesseur[26].
» Voilà un puissant argument en faveur du récit sobre et détaillé de
Néphi, dont nous pourrions pardonner les erreurs de détail si nous
pouvions les découvrir. En parlant de Léhi dans le Désert, nous avons,
pour ainsi dire, amené le vieux patriarche à la barre comme témoin dans
le procès de Joseph Smith contre le Monde. Smith a été accusé (et
comment!) de pratiques frauduleuses, et Léhi est témoin pour la défense.
Il affirme avoir passé des années dans certaines parties du
Proche-Orient il y a environ 2550 ans. Dit-il la vérité ?
Des générations
d’accusateurs astucieux et décidés n’ont pas pu ébranler le témoignage
de Léhi ni le surprendre en flagrant délit de contradiction avec lui-même.
Cela devrait suffire à satisfaire les gens les plus critiques. Mais voici
que de l’Orient viennent de nouveaux témoins: le capitaine Hoshaiah de
Lakish, une armée d’explorateurs bronzés, revenus des déserts de Léhi
pour nous dire comment y est la vie, les anciens poètes des Arabes, des
caisses et des caisses de pièces à conviction de A à Z, des sceaux, des
inscriptions, des lettres, des débris de poteries venus de la propre
patrie de Léhi. Qui aurait jamais pensé que Léhi serait un jour
confronté avec des témoins oculaires des scènes mêmes qu’il prétend
avoir vues ? À la lumière de toutes ces nouvelles preuves, la défense
demande que l’on ouvre à nouveau le procès.
C’est ainsi
que Léhi et les nouveaux témoins sont examinés contradictoirement et
leurs réponses comparées. Les questions pleuvent dru : Comment vous
appelez-vous ? Ne savez-vous pas qu’il n’y a pas de nom de personne
comme cela ? (On présente un tesson datant de l’époque de Léhi
portant le nom Léhi, qui n’est pas rare.) Où habitiez-vous à
l’époque ? Qu’entendez-vous par « pays de Jérusalem » ? Vous ne
voulez pas dire la ville ? (La
défense montre une vieille lettre montrant que le territoire entourant la
ville était appelé pays de Jérusalem.) Qui gouvernait Jérusalem ? Quel
genre d’hommes étaient-ils? Qu’avez-vous fait pour vous les mettre à
dos ? Où avez-vous été chercher cette grande richesse dont parle votre
fils ? Par quel hasard avez-vous appris l’égyptien – n’était-ce
pas un gaspillage de temps ? Pourquoi n’avez-vous pas appris le
babylonien, langue bien plus proche de la vôtre ? Pourquoi se
chamaillait-on dans votre famille ? J’ai toute une liste de noms ici,
votre soi-disant famille et vos descendants. Attendez-vous du tribunal
qu’il croie qu’ils sont authentiques ? Si c’est une liste
authentique, pourquoi ne contient-elle pas de noms en Baal ? Vous dites
que vous avez eu des songes: à quel sujet ? Une rivière ? Quel genre de
rivière ? Qu’est-ce que cet étrange « brouillard de ténèbres »
? Avez-vous jamais rien vu de semblable lorsque vous étiez éveillé ? (Des dizaines de témoins
attestent.) Ne pensez-vous
pas qu’un rêve est un prétexte bien mince pour quitter votre maison et
votre pays ? Dans quelle direction vous êtes-vous enfui? Comment
pouviez-vous constituer une grosse caravane sans être appréhendé ?
Qu’avez-vous emporté ? Comment avez-vous voyagé – à pied ? Comment
avez vous fait pour survivre avec des femmes et des enfants dans un
terrible désert ? Comment avez-vous fait pour ne pas être massacrés par
des razzieurs ? Ne savez-vous pas que ce désert était très
dangereux ? Que mangiez-vous
? Marchiez-vous constamment ? Lorsque vous campiez, quelle était la première
chose que vous faisiez ? Quel genre d’autel ? Quel genre de gibier
chassiez-vous ? Où ? Comment ? Qui s’occupait de la chasse ? Votre fils
a fait un arc, dites-vous: où, dans l’Arabie désertique, pouvait-il
trouver du bois pour en faire un ? Quel droit aviez-vous de vous en aller
donner des noms nouveaux aux lieux ? Pensez-vous qu’une personne sensée
donnerait à une rivière et à sa vallée des noms différents ?
(Rugissement de protestation de la part des Arabes de l’auditoire). Qui
a jamais qualifié la mer Rouge de source ? Ne savez-vous pas qu’il
n’y a pas de rivières en Arabie ? Ce petit discours que vous avez fait
à vos fils au bord de la rivière – est-ce que vous n’en faites pas
un peu trop ? (Nouvelles protestations de la part des Bédouins.) Ne
pensez-vous pas que c’est plutôt ridicule de dire d’une vallée
qu’elle est « ferme et constante » ? Où vos fils ont ils logé
lorsqu’ils sont retournés à Jérusalem ? Et cette caverne ? Les
plaques de métal ne sont-elles pas un support d’écriture plutôt peu
maniable pour y inscrire des textes ? Cinquante hommes ne sont-ils pas une
garnison ridiculement petite pour une ville comme Jérusalem ? Vous décrivez
des réunions nocturnes entre les Anciens et le commandant : Ne
serait-il pas beaucoup plus sensé de tenir les réunions en plein jour ?
Vous voulez faire croire à la cour que vous avez réellement emmené du
blé avec vous dans ce long et épuisant voyage ? Essayez-vous de dire au
tribunal que vous avez trouvé un paradis à l’extrémité méridionale
du pays le plus désolé de la terre ?
Etc. etc. Le
lecteur peut en ajouter à volonté à cette liste de questions pénétrantes
– notre étude indique plus d’une centaine de possibilités, la
plupart étant des questions auxquelles personne sur la terre
n’aurait pu répondre correctement il y a cent vingt ans. L’auteur de
1 Néphi se trouvait en face de cent problèmes délicatement interdépendants,
d’une difficulté extrême. La probabilité de tomber juste par le fait
du hasard est assez mince, mais les chances de rééditer cet exploit une
centaine de fois à un rythme rapide sont infimes. Le monde dans lequel Léhi
errait était pour l’Occidental de 1830 un bourbier mouvant sans la
moindre trace visible d’entroit où prendre pied, perdu dans un
brouillard impénétrable; les meilleurs spécialistes de la Bible étaient
terriblement mal renseignés même sur la Palestine. L’étude
scientifique de la Terre Sainte a commencé avec Edward Robinson en 1838,
et pourtant quarante ans plus tard, une grande autorité écrivait : « Il
y a peu de pays où l’on voyage plus qu’en Palestine; et il y en a peu
dont on connaisse moins les us et coutumes de la population...[27] »
Dix ans plus tard, le Palestine Exploration Fund faisait cette déclaration
officielle : « On ne connaît pour ainsi dire rien de précis sur le désert
de l’Errance[28]. » La Bible elle-même,
au lieu de résoudre les problèmes, est, selon Palmer, la cause
principale des « grandes divergences » que l’on trouve dans les
rapports des observateurs[29]. L’exemble classique en
est le Kadesh Barnea du Dr H. Clay Turnbull, recommandé par de
grandes autorités en 1884 comme étant l’ouvrage classique sur le désert
du sud et « accepté par les géographes bibliques comme étant
l’autorité sur la région », et ce jusqu’à nos jours, lorsque
Woolley et Lawrence explorèrent la région et découvrirent que ce guide
infaillible était simplement « de la fantaisie »[30]. Quant au travail de
Clarke sur la même région, publié un an après celui de Turnbull, les mêmes
critiques se contentent de faire cette réflexion: « Sans commentaires »[31].
Dès 1935, le colonel Newcombe pouvait écrire: « J’avais plusieurs
livres au sujet des Errances, mais presque tous avaient été écrits par
des visiteurs idéalistes mais très inexpérimentés… La plupart de ces
livres étaient tout à fait à côté de la vérité par manque de
connaissance du pays ou de compréhension de l’esprit bédouin. Chacun
semblait exagérer grossièrement sa petite théorie aux dépens de celles
des autres[32].» Que l’on ne croie donc
pas que l’accès à la Bible aurait facilité la tâche de composition
de l’histoire de Léhi – cela n’aurait fait que compliquer les
choses. Cependant nous voyons que notre guide est confiant et avance avec
assurance, ne revenant jamais sur ses pas pour changer d’itinéraire,
n’hésitant jamais un instant ni ne cherchant refuge dans des paroles
vagues qui n’engagent à rien, ne demandant jamais à être excusé ni
ayant recours au vieux truc qui consiste à demander à être compris
uniquement dans un sens « religieux », ne se cachant jamais derrière un
écran de fumée et ne devenant pas consciemment ou inconsciemment confus
ou compliqué.
Quelques contrôles simples
Le présent
traitement de l’histoire de Léhi laisse beaucoup à désirer (nous
pouvons, nous, nous permettre de demander l’indulgence du lecteur pour
avoir utilisé le terme Juif trop libéralement ou nous être engagés
dans des suppositions assez fumeuses sur le langage), mais si une fraction
seulement de nos informations a
été bonne, il est impossible d’expliquer 1 Néphi en disant que
c’est une simple coïncidence. Pour illustrer ceci, que le lecteur fasse
un essai tout simple. Qu’il se mette à écrire l’histoire de la vie,
disons au Tibet au milieu du Xle siècle ap. J.-C. Qu’il bâtisse entièrement
son histoire sur la base de ce que le hasard veut qu’il sache à ce
moment précis sur le Tibet au onzième siècle – cela représentera
assez bien ce que l’on savait de l’Arabie ancienne en 1830, c’est-à-dire
que l’endroit existait et qu’il était très mystérieux et
romantique. En composant votre fantaisie tibétaine, vous jouirez d’un
grand avantage : étant donné que la toile est entièrement vide,
libre à vous de la remplir de tout ce qui vous vient à l’idée. Vous
ne devriez donc pas avoir beaucoup de difficulté à « démarrer
votre récit en douceur », chose qui, de l’avis de Mrs. Brodie [un des
principaux écrivains anti-mormons (N. d. T.)], était le seul obstacle
que devait surmonter l’auteur du Livre de Mormon. Mais il y aura
d’autres obstacles, car dans votre chronique sur l’ancien Tibet, nous
devons insister pour que vous observiez scrupuleusement un certain nombre
de conditions ennuyeuses : (1) Vous ne devez jamais dire quelque
chose d’absurde, d’impossible ou de contradictoire; (2) une fois que
vous avez terminé, vous ne devez pas faire de changement dans le texte
– la première édition doit rester définitive; (3) vous devez affirmer
que votre « récit en douceur » n’est pas un roman mais une
histoire vraie, que dis-je, sacrée; (4) vous devez inviter les
orientalistes les plus capables à examiner le texte avec soin, et vous
efforcer diligemment de faire en sorte que votre livre tombe entre les
mains des personnes qui désirent le plus vivement en dévoiler tous les défauts
et qui sont les plus compétentes pour le faire. « L’auteur » du Livre
de Mormon observe scrupuleusement toutes ces règles terrifiantes.
Dans votre épopée
tibétaine, vous pourriez de temps en temps, par un heureux hasard, dire
quelque chose de correct, mais ne vous y attendez pas. Vous pouvez vous
consoler en prenant un bon roman historique traitant du monde antique et y
marquer au crayon rouge tous les anachronismes, toutes les incongruités
et toutes les inexactitudes du livre. Le résultat sera du carnage, mais
soyez miséricordieux ! Pour vous rendre compte des difficultés que doit
affronter l’historien créatif, il suffit de contempler les laborieuses
productions des derniers critiques du Livre de Mormon. Il n’a été que
trop facile au présent auteur, à qui il manque l’avantage injuste
d’avoir de l’esprit ou de l’érudition, de montrer en quoi Mrs
Brodie, en composant l’histoire d’événements qui ne remontent qu’à
cent ans, se contredit à maintes et maintes reprises[33].
Un Victor Hugo
ou un Anatole France peuvent raconter une histoire convaincante
lorsqu’ils sont proches de leur pays et de leur temps, mais qu’un
auteur, même le plus savant, retourne en arrière d’un ou de deux millénaires
et de quelques milliers de kilomètres autour du globe, et voilà qu’il
se trouve sur un terrain glissant auquel il ne peut échapper qu’en
ayant recours aux ailes de l’imagination. Ce ne sont pas tellement les détails
particuliers, mais plutôt le cadre et l’atmosphère générale de leurs
histoires qui obligent Messieurs White et Douglas à faire un clin
d’oeil entendu et à nous dire que tout est pour rire. N’importe quel
manuel sur l’antiquité grecque ou romaine peut fournir à un auteur
tous les détails précis qu’il lui est possible d’utiliser, mais
aucun écrivain n’a encore réussi à intégrer une masse de ce genre
d’information dans un ensemble simple, naturel et sans faille. Thornton
Wilder et Naomi Mitchison évitent très bien les pièges de la
reconstitution historique en se concentrant sur des choses aussi indépendantes
du temps que les montagnes, les mers et les émotions humaines et rendent
ainsi leurs histoires convaincantes. Mais Néphi ne jouit pas de ce luxe
ou de ces immunités artistiques: c’est de l’histoire qu’il écrit,
et il donne ses informations dans un discours tellement simple, fluide et
naturel que le lecteur passe facilement à côté de la grande quantité
de détails qui sont imbriqués dans cette forme naturelle et sans
complexité. Quel auteur de fiction historique s’est jamais approché, même
de loin, de pareil exploit ?
Mais
n’avons-nous pas été décidément partial dans notre traitement de Léhi
? Bien sûr que si. Nous sommes l’avocat de la défense. Nos témoins,
c’est nous qui les avons tous choisis, mais nul ne peut nier qu’ils
soient compétents et sans préjugés. Nous avons invité l’accusation
à les examiner. Jusqu’à maintenant elle ne l’a pas encore fait, mais
au lieu de cela a introduit ses propres témoins à la cour, des
intellectuels modernes qui peuvent nous dire très exactement ce que pensait
l’accusé lorsqu’il a écrit le Livre de Mormon. Ces preuves-là
n’en sont pas du tout – c’est de la mauvaise science, de la mauvaise
histoire et même du mauvais reportage journalistique et serait rejeté
par n’importe quel tribunal du pays. Mais cela pourrait impressionner le
jury à moitié instruit, et c’est là son but. La meilleure manière
pour nous d’expliquer la nouvelle tendance qui se manifeste dans la
critique du Livre de Mormon, c’est d’utiliser une petite parabole.
Un jeune homme
prétendit un jour avoir trouvé, tandis qu’il labourait, un gros
diamant dans son champ. Il exposa gratuitement la pierre au public et tout
le monde prit parti. Un psychologue montra, en citant certains cas célèbres,
que le jeune homme souffrait d’une forme bien connue de psychose. Un
historien montra que d’autres hommes ont également affirmé avoir trouvé
des diamants dans des champs et s’étaient trompés. Un géologue prouva
qu’il n’y avait pas de diamant dans la région, mais seulement du
quartz: le jeune homme avait été trompé par un morceau de quartz.
Lorsqu’on lui demanda d’examiner la pierre elle-même, le géologue
refusa avec un sourire las et tolérant et en secouant gentiment la tête.
Un professeur d’anglais montra que le jeune homme, en décrivant sa
pierre, utilisait exactement le même langage que celui utilisé par
d’autres personnes décrivant des diamants non taillés. Il utilisait
donc simplement le langage courant de son époque. Un sociologue montra
que trois seulement sur cent soixante-dix-sept employés de fleuristes
dans quatre grandes villes croyaient que la pierre était authentique. Un
ecclésiastique écrivit un livre pour montrer que ce n’était pas le
jeune homme mais quelqu’un d’autre qui avait trouvé la pierre.
Finalement un
bijoutier indigent du nom de Snite fit remarquer que puisqu’on avait
encore accès à la pierre pour l’examiner, la réponse à la question
de savoir si c’était un diamant ou pas n’avait absolument rien à
voir avec la personne qui l’avait trouvée ou avec le fait qu’elle était
honnête ou saine d’esprit ou que quelqu’un la croyait ou qu’elle était
capable de faire la distinction entre un diamant et une brique ou qu’on
n’avait jamais trouvé de diamant dans les champs ou que des gens
avaient déjà été trompés par du quartz ou du verre, mais qu’on
devait y répondre simplement et uniquement en faisant subir à la pierre
certains tests bien connus pour les diamants. On fit venir des experts en
diamant. Certains le proclamèrent authentique. Les autres plaisantèrent
nerveusement et déclarèrent qu’ils ne se voyaient pas mettre leur
dignité et leur réputation en danger en faisant semblant de prendre la
chose trop au sérieux. Pour cacher la mauvaise impression ainsi donnée,
certains proposèrent la théorie que la pierre était en réalité un
diamant synthétique, très adroitement fait, mais un faux quand même.
L’objection à cela c’est que la production d’un bon diamant synthétique,
il y a cent vingt ans, aurait été un fait encore plus remarquable que la
découverte d’un diamant réel.
La morale de
cette histoire est que le témoignage rendu par l’accusation, si savant
soit-il, a été jusqu’à maintenant entièrement à côté de la
question et négligeable. Inutile d’observer qu’il est également
incompétent, puisqu’il vise surtout à la controverse et est basé entièrement
sur les conclusions des témoins, lesquels ont d’autre part déjà décidé,
pour d’autres raisons, que l’accusé est coupable.
Autre chose:
L’accusation doit apporter la preuve absolue de sa thèse; il ne suffit
pas de montrer, même si elle le pouvait, qu’il y a des erreurs dans le
Livre de Mormon, car tous les humains en commettent ; ce qu’elle
doit expliquer, c’est comment « I’auteur » du livre est arrivé
à tomber juste aussi souvent. Quelque quatre-vingts années de recherches
zélées de la part du Palestine Exploration Fund n’ont pour ainsi dire
rien apporté pour prouver l’Exode; aujourd’hui encore, « de
l’histoire de... Saül, David, Salomon ou même de leur existence, il
n’y a absolument aucune trace en dehors de la Palestine ». Et pourtant
ce manque de preuves ne réfute en rien la Bible. Nous n’aurions pas été
désappointés ou surpris de trouver tous les documents complètement
silencieux sur ce qui a trait au Livre de Mormon; et cependant ils ont été
très loin de l’être. Si un homme commet une erreur lorsqu’il résout
un problème très complexe de mathématiques, cela ne prouve rien quant
à ses capacités de mathématicien, car les plus grands commettent des bévues.
Mais s’il montre une solution correcte au problème, il est impossible
d’expliquer son succès en disant que c’est un accident, et nous
devons le tenir, quel qu’il soit, pour un mathématicien authentique; il
en va de même de l’auteur de 1 Néphi : Si nous pouvions trouver des
erreurs dans son œuvre, nous pourrions facilement les expliquer et les
pardonner, mais lorsqu’il ne cesse de donner réponse correcte sur réponse
correcte, nous ne pouvons qu’accepter l’explication qu’il donne sur
la manière dont il s’y prend.
Il y a un
aspect significatif de l’histoire de Léhi dans le Désert que nous ne
pouvons pas passer sous silence. Elle est entièrement, du début à la
fin, une histoire de l’Ancien Monde. On n’y trouve pas le moindre
indice sur le « noble peau-rouge ». On n’y trouve rien qui laisse soupçonner
si peu que ce soit que l’histoire va prendre fin dans le Nouveau Monde.
Le peuple de Léhi pensait avoir trouvé sa terre promise au pays
d’Abondance près de la mer et fut extrêmement irrité lorsque Néphi,
qui lui-même avait considéré le projet comme impossible (1 Néphi
17:8-9), entreprit, en vertu d’instructions spéciales, de construire un
bateau.
De quel roman oriental le livre de 1 Néphi a-t-il donc été volé ? Comparez-le aux tentatives de saisir la lettre et l’esprit du somptueux Orient, de Voltaire à Grillparzer, que dis-je, aux histoires orientales les plus sobres de l’époque, et il se révélera immédiatement à quel point elles sont toutes irréelles, extravagantes, exagérées et stéréotypées, et avec quel soin scrupuleux Néphi a évité tous les pièges dans lesquels les meilleurs savants eux-mêmes étaient sûrs de tomber. Il n’y a absolument aucune raison de poser la question: Qui a écrit le Livre de Mormon ? Il aurait été tout aussi impossible au plus grand savant vivant en 1830 d’écrire le Livre de Mormon qu’à Joseph Smith. Et quiconque veut expliquer le Livre de Mormon par une des théories proposées jusqu’à présent – à l’exception d’une seule – doit complètement exclure les quarante-huit premières pages.
[1] J.
A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, Leipzig, Hinrich, 1915; réimprimé
Aalen, Zeller, 1964, 1:372-73, tablette 74.
[2] Tite-Live,
Ab Urbe Condita (Depuis la fondation de la ville) VIII, 40, 4;
cf. IV, 16, 3 ; tenu sur des « planches » (tabulae, pinakes)
ou tablettes sacrées (en hierais deltois), Denis
d’Halicarnasse, Histoire des Romains I, 73, 1; I, 74, 3-5.
[3]
Julian Obermann, « An Early Phoenician Political Document », JBL
58, 1939, pp. 229-31. Albright l’appelle « une lettre hébraïque du 12e
siècle » sur une plaque de cuivre ou de bronze. William
F. Albright, « A Hebrew Letter of the Twelfth Century », BASOR
73, février 1939, pp. 9-13.
[4] Le
passage d’Odroso est cité in extenso par E. A. Wallis Budge, The
Book of the Dead, New York, Dover, 1967, xix, n. 3.
[5] G.
Ramadas, « Kesaribeda Copper Plate », Journal of Bihar
Research Society 34, 1948, pp. 32, 34-35, mentionne en plus de
celles-ci les plaques de Mattapad de Damodaravarman 16,20 x 3,8 cm;
les plaques Kauteru de Vijayaskandavarman 14 x 2 cm; les plaques
Peddavegi de Salankayan à Nandivarman 17,3 x 5,3 cm; les plaques de
cuivre Koroshanda de Visakharvarma 19 x 5 cm; les plaques Chikulla de
Vikramendravarma 18 x 5,7 cm; les plaques Komarti de Chandavarma 19 à
19.4 x 5,7 à 6 cm.
[6] Alonzo
Bunker, « On a Karen Inscription-Plate », JAOS 10, 1872,
pp. 172-77.
[7] Elle
avait 15,7 x 5,4 cm. Id., p. 175.
[8] Voir
Fritz Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, Munich,
Beck, 1926, pp. 201-203.
[9] E.
B. Cross, « The Karens », JAOS 4, 1854, p. 308.
[10] Eduard
Meyer, Geschichte des Altertums, 2e éd., Stuttgart, Cotta,
1928, vol. 2, 1e partie, p. 205; R. Maxwell Hyslop, etc., « An
Archaeological Survey of the Plain of Jabbul, 1939 », PEFQ, 1942,
p. 23, plaque VII, fig. 14; une arme cérémonielle de fer découverte
récemment avait une poignée de cuivre et d’or finement ouvragée. Theodore H. Gaster, « On an Iron Axe from
Ugarit, » PEFQ, 1943, pp. 57-58.
[11]
Gerald A. Wainwright, « The Coming of Iron », Antiquity 10,
1936, pp. 17-18.
[12] Id.
[13] Georg
Jacob, Altarabisches Beduinenleben, Berlin, Mayer & Müller,
1897, pp. 151-52.
[14]
Philip J. Baldensperger, « The Immovable East, » PEFQ, 1903,
p. 168. Nibley
poursuit dans son article pour le magazine: « La question générale
de l’acier dans le monde antique n’est pas encore réglée. Les
Babyloniens distinguaient entre eru, cf. l’anglais ‘ore’,
signifiant fer, plomb ou cuivre, et le ‘eru brillant’, qui
signifiait cuivre ou acier ». Fr. Lenormant, ‘Les noms de
l’Airain et du Cuivre…’, Biblical Archaeological Society
Transactions 5, 1876, pp. 344-345. En Égypte, on faisait une
distinction semblable entre le fer ordinaire, qui non seulement était
connu, mais utilisé pour des ustensiles dès l’Ancien Empire, et le
type de fer appelé tehazet, dans lequel certains voient le fer
asiatique. Felix von Luschan, « Eisentechnik in
Afrika », Zeitschrift für Ethnologie 41, 1909, p. 47. Un
autre type, le benipe, est le ‘fer du ciel’, c’est-à-dire
soit le fer météorique ou, comme le croyait Von Luschan, un ‘métal
couleur ciel’, Metall von Himmelsfarbe, id., p. 48, qui pourrait très
bien avoir été de l’acier. Les épées de cérémonie dans de très
vieilles peintures funéraires égyptiennes sont de couleur bleue pour
représenter le fer ou l’acier, selon la même autorité, id. p. 49.
Bien que le problème de l’origine et de l’ancienneté du fer et
de l’acier ne soit toujours pas résolu, toutes les constatations
faites ces quarante dernières années ont tendu à prouver une
antiquité beaucoup plus grande et une utilisation beaucoup plus répandue
de ces métaux que ce que l’on croyait précédemment possible. » Hugh W. Nibley, « Lehi in the Desert
», IE 53, 1950, p. 707.
[15]
Richard F. Burton, Pilgrimage to Al-Medinah and Meccah, Londres,
Tylston & Edwards, 1893, 2:94, pp. 141-42.
[16]
John A. Widtsoe, « Is Book of Mormon Geography Known ? » IE 53,
1950, p. 547.
[17]
Bertram Thomas, Arabia Felix, New York, Scribner, 1932, pp.
48-49.
[18]
Id., p. 48.
[19]
Burton, Pilgrimage to Al-Medinah and Meccah, 2:130.
[20]
David G. Hogarth, The Penetration of Arabia, Londres, Lawrence
& Bullen, 1904, pp 137-19.
[21]
Id., p. 148-150.
[22]
James L. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphie,
University of Pennsylvania Press, 1934, pp. 71, 74 .
[23]
Josiah Conder, A Popular Description of Arabia, Modern
Traveller Series, Londres, Duncan, 1926, pp. 9, 14-15, 348-349.
[24]
Stewart Perowne, « Notes on I Kings, Chapter X, 1-13 », PEFQ,
1939, p. 200.
[25] Montgomery,
Arabia and the Bible, p. 75.
[26]
Robert E. Cheesman, In Unknown Arabia, Londres, Macmillan,
1926, pp. 67-71.
[27] C.
Clermont-Ganneau, « The Arabs in Palestine », PEFQ, 1875, pp.
202.
[28]
Edward H. Palmer, « The Desert of the Tíh and the Country of Moab »,
dans Survey of Western Palestine, Special Papers, Londres,
Palestine Exploration Fund, 1881, 4:73.
[29]
Edward H. Palmer, The Desert of the Exodus, Cambridge,
Deighton, Bell, 1871, p. 2.
[30]
Charles M. Watson, « The Desert of the Wanderings », PEFQ, 1914,
pp. 18-23; C. Leonard Woolley & Thomas E. Lawrence, The
Wilderness of Zin, Londres, Cape, 1936, pp. 71-72.
[31]
Woolley & Lawrence, The Wilderness of Zin, p. 73, n. 1.
[32] S.
F. Newcombe, « T. E. Lawrence – Personal Reminiscences », PEFQ,
1935, pp. 110-11.
l Accueil l
Écritures l Livres
l Magazines l Études
l Médias l Art
l